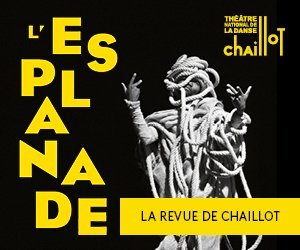Pour le mauvais lecteur
Je dois le signaler tout de suite : je n’ai jamais été très convaincu par l’idée, souvent implicite mais très vivace, qu’il conviendrait de bien lire les textes.
Il faut dire qu’en la matière je n’ai jamais été un bon élève. J’ai mis du temps à rentrer dans le rang et, encore aujourd’hui, j’ai du mal à y rester. Il m’arrive fréquemment de lire des œuvres et de les refermer en avouant que je n’ai pas la moindre idée de ce qu’elles voulaient bien dire. De nombreuses raisons peuvent expliquer ce phénomène : obscurité du texte, concepts théoriques non explicites, raisonnement alambiqué… Je pourrais ainsi me borner à incriminer l’œuvre et son auteur, les textes abscons ou illisibles étant en eux-mêmes un véritable sujet de réflexion – au demeurant passionnant.
Mais il me semble qu’à privilégier ces pistes, on délaisse une question qui n’a peut-être pas suffisamment retenu l’attention : cette impossibilité à percer le sens du texte ne provient-elle pas de moi ? Et à ce titre, cette expérience de lecture m’amène à me demander – même si cela peut déplaire – si je n’ai pas été un mauvais lecteur. Le mot est lâché et il me semble qu’il est grand temps de redonner sa place à ce lecteur si injustement décrié depuis des siècles.
La première difficulté, pour qui souhaite réfléchir attentivement à la mauvaise lecture, est d’en proposer une définition. La chose est loin d’être gagnée d’avance – le mauvais lecteur ayant plus d’une corde à son arc.
Durant des siècles, la mauvaise lecture n’a d’abord eu presque qu’un seul visage : l’identification immodérée aux personnages d’une œuvre. Quand les lecteurs des Souffrances du jeune Werther ont par exemple commencé à attenter à leurs jours en imitant le héros de Goethe, il s’est confirmé ce qu’on craignait depuis longtemps : la lecture par identification est une des plus mauvaises qui soit – et une des plus dangereuses. C’est elle qui avait déjà plongé Don Quichotte dans la folie et qui poussera un peu plus tard Emma Bovary