Les semblants de la cancel culture
Par le plus grand des hasards, alors que je relis le livre d’Eduardo Viveiros de Castro, L’inconstance de l’âme sauvage [1], découvert en 2005 à Belo Horizonte sur les conseils de mes amis Ruben Queiroz et César Guimaraes, je vois débarquer chez nous ce qui se présente comme « cancel culture ».
Quel rapport entre les deux ?
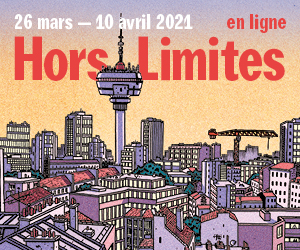
Aucun. Pure coïncidence. Les Tupinamba (l’un des peuples amérindiens étudiés par Viveiros de Castro), disséminés tout au long de la côte du Brésil, ont pour habitude et d’une certaine façon pour règle de dévorer leurs ennemis capturés à la guerre, ce qu’ils font collectivement, hommes, femmes et enfants. Les honorables pères jésuites arrivés devant ces « Indiens », horrifiés, entreprennent immédiatement de les convertir. À leur grand étonnement, les Amérindiens s’empressent de croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à la Vierge, aux sacrements, aux miracles et aux Saints.
Mais la joie des jésuites ne dure pas : alors même que les Amérindiens se rendent à la messe, qu’ils prient, qu’ils donnent tous les signes de la foi, il y a un point sur lequel ils ne cèdent rien : faire la guerre à l’ennemi (d’autres Amérindiens Tupi) et manger les captifs.
Les jésuites osent une image, comparant une statue de myrte, facile à tailler, à modeler, mais qui persiste à pousser, et une statue de marbre, plus difficile à travailler mais dont la mise en forme ne bouge plus. L’inconstance de l’âme sauvage est là : croire sans croire, adopter les nouveaux rites (d’autant plus facilement qu’il n’y avait pas chez eux d’Olympe païen ou de Trinité chrétienne), mais ne renoncer ni à la guerre entre tribus ni au cannibalisme. Grande est la confusion des jésuites. Qui prennent – tardivement – conscience de ce qu’une conversion peut ne pas être définitive. Ils la croyaient de marbre, elle est de myrte. Croire est une chose, renoncer à ce qui – de fait – n’est pas une « croyance », mais la raison même de vivre ensemble, en est une autre.
Il y a chez Eric Zemmour une
