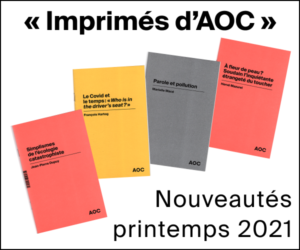Cancel Culture : la censure euphémisée
L’extrême-droite assume. La censure, notamment des œuvres d’art, n’est pas un mot qui lui fait peur. Elle la réclame, elle l’a pratiquée quand elle était aux commandes de certaines municipalités (souvenons-nous de Vitrolles !) sans aucune forme de pudeur. Lorsqu’elle monte à l’assaut pour réclamer la censure d’une œuvre, elle soulève des troupes qui n’ont cure de voir l’œuvre dénoncée, et reprennent en chœur les reproches, en général moraux, énoncés par les chefs : heurt des convictions, des croyances ou bien, de façon opportuniste, protection de la sensibilité des enfants dont elle se fait une conception toute particulière. Réclamer la censure est une façon, pour l’extrême-droite, de mener sa bataille culturelle, et de faire advenir son vieux rêve de régenter le monde du visible et du sensible.
Ses thèses et ses pratiques auraient-elles gagné en ampleur ? Auraient-elles contaminé des mouvements qui ne partagent en aucune manière ses thèses ? C’est ce qui nous inquiète.
Depuis 2009, de nouveaux acteurs réclament la censure d’œuvres que, jusque-là, seule l’extrême droite et quelques associations familialistes proches de ses thèses attaquaient. Avec la mobilisation de cinq organisations féministes contre le chanteur Orelsan, un verrou saute, celui de l’incompatibilité entre l’appartenance au camp progressiste, terreau habituel du féminisme, et la revendication de censure contre des œuvres ou des artistes. À ce type de mobilisations s’ajoutent de nouvelles organisations anti-racistes réclamant à leur tour des interdictions de diffusion d’œuvres devant les tribunaux, ou organisant des campagnes pour faire annuler sans décision de justice des spectacles, des films, des concerts, etc… Ceux-là n’assument même pas être devenus des censeurs.
Aussi est-il nécessaire de nous interroger sur les motivations de ces nouveaux acteurs d’une censure euphémisée, sur la cohérence entre leurs actions et leurs convictions ; et, puisqu’ils le contestent, sur la pertinence du terme même de censure pour désigner leurs campagnes.
Parmi leurs motivations, la première est évidente et commune : agir contre un artiste connu permet d’attirer l’attention des médias sur « la cause » que l’on défend et que l’on peine à faire valoir. Il paraît donc que le remède à ce manque de visibilité constituerait un réel progrès des causes féministes et antiracistes, ce qui suppose un consensus social qui, à bien des égards, est loin d’être constitué. D’une part, chacun peut mesurer les écarts entre les principes d’égalité et leur application réelle, d’autre part, la diversification des acteurs dans chaque champ de revendication a rendu la possibilité d’un consensus entre le corps social revendiquant et le pouvoir institué extrêmement complexe, mais aussi entre militants d’une même cause qui peuvent s’opposer sur les méthodes et sur le fond : il n’a échappé à personne que l’époque est au morcellement politique.
Ce qui aurait dû servir de repoussoir – l’histoire de la censure et le fait qu’elle ne soit plus portée, dans sa forme militante, que par l’extrême-droite ou l’extrémisme religieux –, aurait dû faire réfléchir ces mouvements qui ne partagent pas ces vues. Mais l’extrême-droite a obtenu de jolis succès et ce militantisme contre les œuvres porte peu à peu des fruits. Chacun a pu observer récemment ce qui se passe dans le champ du cinéma. L’association Promouvoir y a fait la pluie et le beau temps de la censure depuis plusieurs décennies, dans une passivité politique générale. Rappelons qu’elle est membre du Comité d’initiatives pour la dignité humaine créé en 1994, afin de lutter contre le préservatif et « rétablir la vérité sur le sida » contre « les hordes libertaires et maçonniques [1] ».
Ses statuts indiquent que cette association milite en faveur de la dignité selon une conception toute particulière. La famille est hétérosexuelle, sa formation a pour fin la conception des enfants, et l’avortement devrait être interdit. Le système scolaire devrait respecter ses « valeurs morales ». Dans les faits, le cinéma d’auteur est son unique cible.
Elle a pu jouer un rôle dans cette sphère, parce qu’en France, aucun film ne peut être exploité en salle sans une autorisation du ministre de la Culture qui délivre un visa d’exploitation. Ce système de censure préalable exercée par le pouvoir exécutif n’existe plus que pour le cinéma, dernier art déclaré dangereux – il a été supprimé pour le théâtre au début du XXe siècle. Le visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ou du respect de la dignité humaine.
Soyons justes : Promouvoir n’a pas fait le travail seule. Depuis les années 1990, la censure des œuvres cinématographiques a été renforcée à de nombreuses reprises, sous la pression d’associations familialistes, sous la présidence de Jacques Chirac, et c’est dans cette brèche que Promouvoir s’est engouffrée, enchaînant les succès, faisant d’abord annuler l’interdiction aux moins de 16 ans de Baise-moi, de Virginie Despentes et Coralie Trinh-Thi, jugée insuffisamment protectrice des jeunes entre 16 et 18 ans, ce qui conduisit Catherine Tasca, pour éviter au film le classement X, à rétablir l’interdiction aux moins de 18 ans supprimée dans la période précédente, plus libérale.
Au tournant des années 2000, la réclamation de censure se répand chez les associations de défense des enfants. L’exposition Présumés innocents, à Bordeaux, fait l’objet d’une plainte devant le doyen des juges d’instruction par une association de recherche des enfants disparus, La Mouette, plainte qui a débouché sur un non-lieu presque 10 ans plus tard. Le mal est fait à l’encontre du monde de l’art contemporain qui se met à redouter des menaces fondées sur un dispositif légal conçu au moment de la réforme du code pénal, en 1994. Abolissant l’ancien délit d’outrage aux bonnes mœurs, le législateur le remplace par un délit de diffusion de messages violents, pornographique ou attentatoire à la dignité : dès qu’un mineur peut voir, entendre, être en présence du message, le délit serait constitué. Si l’on appliquait ce dispositif à la lettre (mais quelle lettre, tant ces notions sont élastiques ?), il faudrait vider massivement les lieux de culture.
Quel groupe n’aurait pas droit de faire valoir son avis sur les œuvres ?
Cette loi, proposée par la gauche du parti socialiste de l’époque, a permis de mettre progressivement l’audiovisuel en coupe réglée : le cinéma et la télévision se sont vus contraints, sous la menace pénale, de réguler leur programmation et leur production. Promouvoir peut poursuivre sa croisade contre les films d’auteur au prétexte de lutter contre la pornographie ; ses victimes s’amoncellent : Ken Park, de Larry Clark, est interdit aux moins de 18 ans et non aux moins de 16 ans comme l’avait décidé le ministre de la Culture. Ainsi en sera-t-il de Nymphomaniac de Lars von Trier, de La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, lequel approuve, dans Le Monde du 15 décembre 2015, que son film soit interdit aux moins de 16 ans et non aux moins de 12 ans, comme l’avait décidé le ministre.
L’année 2015 est un grand cru pour l’association qui fait annuler les visas de Saw 3D, de Kevin Greutert, et de Love, de Gaspard Noé. Le président de l’association, devenu avocat après avoir été juge administratif, connaît enfin son heure de gloire dans les médias. Vaut-il mieux vivre caché pour réussir ? Sans doute le dévoilement de ses opinions politiques, et de son éviction par Bruno Mégret, perçu comme trop radical, rend-il le juge administratif un peu plus circonspect.
Quand, l’année suivante, l’association s’attaque à Quentin Tarantino pour Les Huits salopards, ou au film Bang Gang, d’Eva Husson, elle échoue. La réalisatrice s’alarme publiquement du fait que le représentant de Promouvoir puisse « décider seul de ce qu’on peut ou de ce qu’on ne peut pas voir en France ». Il « est ahurissant que tant de films, largement salués dans les plus grands festivals et qui n’ont heurté la sensibilité de personne, sinon les promoteurs d’un nouvel obscurantisme, puissent être interdits au public ».
Si cette association a effectivement pesé de tout son poids dans l’application d’une législation du cinéma de plus en plus restrictive, elle a aussi influencé les esprits des gouvernants. Sous la présidence de François Hollande, la censure du cinéma a été renforcée, son gouvernement, dans ses derniers mois, n’ayant rien trouvé de mieux que de prévoir un système de censure automatique liant les mains du ministre de la Culture.
Désormais, lorsque l’œuvre ou le document comporte « des scènes de sexe ou de grande violence de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser », le visa d’exploitation ne peut s’accompagner que d’une interdiction aux moins de 18 ans ou d’un classement X. Il n’est donc plus possible de délivrer un visa de 16 ans pour ces films. On sait qu’une interdiction aux mineurs prive un film de toute diffusion possible à la télévision, alors que les chaînes sont souvent coproductrices ou diffuseurs. Le décret ajoute que le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l’œuvre ou le document peut justifier que le film ne soit pas classé X. Or un film X ne peut sortir dans aucune salle de cinéma, sauf dans celles de cinémas X, qui… n’existent plus.
Pour anticiper ces visas sévères et éviter une catastrophe économique dans un secteur aux coûts de production lourds, la profession censure donc en amont selon des critères subjectifs de plus en plus restrictifs. Voilà donc comment une association d’extrême-droite a réussi à faire plier une profession entière, et comment le gouvernement de Manuel Valls a cédé à sa pression, alors qu’elle ne représente qu’une poignée d’intégristes.
Promouvoir s’est fait doubler sur sa droite par une nouvelle association, Juristes pour l’enfance, présidée par une juriste anti-PMA et GPA, proche de la Manif pour tous, Aude Mirkovic, responsable du Master 1 « droit de la santé et des biotechnologies » de l’université Paris Saclay Évry, et ex-chanteuse de rock dans des groupes identitaires. Dans son viseur, le film d’animation Sausage party, interdit « seulement » aux mineurs de douze ans, sans avertissement.
Mais le Conseil d’État juge que « si le film d’animation en cause met en scène des personnages s’exprimant dans un langage grossier et parfois vulgaire et comporte plusieurs passages pendant lesquels des aliments représentés de manière anthropomorphique consomment de l’alcool et de la drogue et se livrent à des pratiques sexuelles, ces scènes sont représentées sans recherche de réalisme et d’une façon qui se veut humoristique. Elles s’insèrent de manière cohérente dans la trame narrative du film dont le propos est de dénoncer, dans un esprit subversif, la société de consommation et de promouvoir l’hédonisme ».
L’association cria victoire sur son site pour une décision antérieure ne portant que sur des aspects procéduraux, et ne fait aucun écho à sa défaite sur le fond. La désinformation fait partie de la stratégie de ce mouvement. Il n’est pas le seul, mais celui-là est présidé par une universitaire enseignante de droit, ce qui laisse songeur.
Comment des groupes défendant des valeurs opposées peuvent-ils trouver quoi que ce soit de séduisant dans ces pratiques ? Posons la question autrement. Quel groupe n’aurait pas droit de faire valoir son avis sur les œuvres ? Que restera-t-il de la liberté de créer et de diffuser des œuvres si chacun va dans le même sens, au lieu de militer pour le rétablissement du droit de créer ?
La censure, demande d’invisibilisation, est l’instrument délibéré d’une revendication qui considère qu’elle n’arrive pas à se faire entendre.
Hélas, les nouveaux acteurs de la censure réussissent à remporter, eux aussi, de jolis « succès » : les associations féministes ont fait annuler la quasi-totalité de la tournée du rappeur Orelsan en 2009, alors que la justice l’a relaxé de la plainte en incitation à la haine sexiste ; la tournée de Bertrand Cantat en 2018 a été annulée alors qu’il avait le droit de se produire sur scène ; plusieurs projections du film J’accuse, de Roman Polanski, ont été interdites à Nîmes et à Évry dans les salles municipales, par les maires en pré-campagne de réélection.
Si tous les recours contre le spectacle Exhibit B de Brett Bailey ont été rejetés par les tribunaux administratifs, en 2014, il s’est trouvé des militants antiracistes pour passer directement à l’acte et tenter d’empêcher le public d’y avoir accès, comme le firent trois ans plus tôt les catholiques intégristes tentant d’interrompre la pièce de Romeo Castelluci, Sur le concept du visage du fils de Dieu, en montant sur la scène du Théâtre de la Ville, ou la pièce Golgota Picnic, de Rodrigo García, au théâtre du Rond-Point.
Le public a vu ces spectacles sous escorte policière. S’est fait insulter. A vu, sidéré, des prières de rues devant les salles, des défilés de décontamination devant des lieux d’expositions, ou bien des portes de théâtre dégringoler en mille morceaux de verre dans un fracas épouvantable alors que des classes de la Ville de Saint-Denis étaient en cours de visite de l’installation Exhibit B au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Rencontrés le soir même, les élèves expliquaient que ce qui les rendaient le plus tristes, c’était l’impossibilité de dialoguer avec les militants dehors, pour leur expliquer que non, le spectacle n’était pas raciste.
Il est crucial de relever à la fois la contamination des dispositifs d’un acteur de censure à l’autre, et la concentration des uns et des autres sur ces formes de violences, empêchant tout débat, lesquelles tombent sur des objets artistiques parce qu’ils rendent les luttes sociales, et politiques visibles, par la menace qui pèse sur eux. La censure, demande d’invisibilisation, est l’instrument délibéré d’une revendication qui considère qu’elle n’arrive pas à se faire entendre.
Les mouvements ultra-catholiques n’ont aucune peine à revendiquer haut et fort la censure, qui fait partie de leur histoire (ne serait-ce qu’avec l’Index papal). Néanmoins, les nouveaux venus, comme Osez le Féminisme, le Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), la Brigade Anti Négrophobie (BAN) ou Décoloniser les arts, pour les mêmes actions, édulcorent ou refusent le terme de censure, lui préférant celui d’annulation, en référence à la vague influente de la « cancel culture », et justifient la violence infligée par la violence subie.
Il nous apparaît qu’ils se trompent de nom et de cible, puisque les spectacles ne sont pas responsables des discriminations. Exhibit B ne faisait que les montrer et les rendre sensibles ; Bertrand Cantat ne faisait pas l’apologie de sa violence sur scène ; J’accuse, de Polanski, traite de l’affaire du capitaine Dreyfus, un soldat qui ose se dresser contre l’antisémitisme de l’armée – même si le réalisateur n’est pas exempt d’un jeu sur les similitudes de situation en ce qui regarde les rumeurs et les malentendus le concernant.
Ces organisations n’ont, en tout état de cause, pas à se transformer en juges en lieu et place de ceux-ci. Et cela quelle que soit l’œuvre montrée, diffusée, présentée ou représentée. Demander l’annulation d’un spectacle n’est pas de même nature que la critique étayée du même spectacle, même virulente. Une manifestation devant un lieu de culture peut dégénérer en demande de censure, lorsqu’on agit auprès des commanditaires ou des sponsors afin d’exiger la déprogrammation de l’œuvre, ou en censure lorsqu’on empêche physiquement les spectateurs d’accéder à l’œuvre. La censure n’est pas l’apanage de l’État. Elle est protéiforme et constituée dès lors qu’il y a entrave à la liberté de création et de diffusion des œuvres, ce qui constitue d’ailleurs un nouveau délit pénal depuis la loi de 2016.
Ce qui de nos jours est frappant et devient un problème politique est que chacun, fort de sa cause, s’autorise à se transformer en censeur, dénonçant publiquement, accusant tel spectacle de tous les maux sur les réseaux sociaux, le recours au juge étant de plus en plus rare parce que, juridiquement, il n’y a rien à reprocher à l’œuvre ou à l’auteur. Ces militant(e)s s’aveuglent à ce que leurs luttes leur font produire exactement ce qu’ils dénoncent : l’invisibilisation.
Le refus du débat et du jugement critique, au sens donné à cette expression, au XVIIIe siècle, par le philosophe Immanuel Kant, est antidémocratique, puisque la pratique du jugement invite chacun à refuser les ordres secrets et à se forger une opinion dans le but de la soumettre au débat public – fut-ce dans un espace privé –, et repose sur le fondement d’une valeur égale des paroles, attachée à une égalité des droits civiques.
Certains intellectuels fournissent des armes théoriques à ces néo-militants qui s’improvisent apologues de la censure, comme ce fut le cas de certaines organisations étudiantes lors du scandale des Suppliantes à la Sorbonne.
Comme les militants d’extrême-droite – et comme la Congrégation des Évêques de France lors des affaires Castelluci et Garcia, persuadée que ces spectacles étaient blasphématoires [2] sans les avoir vus – ces mouvances de censeurs postmodernes, ne s’assumant pas comme telles, refusent de voir les œuvres qu’ils critiquent, et font en sorte qu’elles deviennent invisibles pour les autres. Comment Amandine Gay sait-elle que les reproches qu’elle adresse à Exhibit B sont constitués, puisqu’elle n’a pas assisté à l’œuvre ? Ces reproches sont très graves, puisqu’il ne s’agit rien de moins que d’accuser l’œuvre de violer la loi, comme en témoigne le titre de son article : « Exhibit B : Oui, un spectacle qui se veut antiraciste peut être raciste. »
Rappelons que tous les recours administratifs pour faire interrompre les représentations au motif que le spectacle aurait été raciste ont échoué. Et aucune organisation dénonçant le spectacle n’a déposé de plainte pénale. Nous sommes donc ici face à un usage délibérément disqualifiant et diffamant du racisme, qui va bien au-delà de la critique. Ou plutôt en deçà, puisqu’aucune critique ne peut avoir lieu sans prendre connaissance de l’œuvre à critiquer.
Demander l’annulation d’un spectacle n’est pas de même nature que la critique étayée du même spectacle, même virulente.
C’est dans le but de légitimer ces dénonciations aveugles qu’un maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 8, Maxime Cervulle, recourt de façon abusive et dévoyée au concept de « public oppositionnel » pour désigner ce public protestataire qui refuse de voir l’œuvre.
L’usage de ce concept emprunté [3] pour désigner le public des œuvres n’est pas cohérent. Le public oppositionnel est celui qui débat, délibère, dialogue, discute et se dispute publiquement et à égalité. C’est celui qui se convoque à la table des discussions (l’espace public) en tant que groupe socialement dominé, qui refuse de se laisser intégrer et cultive, sinon le dissensus, du moins les différences. Le « public oppositionnel » désigne donc un processus de délibération collective dans une perspective de défense et de promotion d’un « bien commun » plus ou moins élargi, en respect des principes de liberté et d’égalité. Il suppose bien évidemment que chacun ait en commun l’objet du débat.
On ne peut donc qualifier de « public oppositionnel » ceux qui refusent de voir une œuvre, puisqu’ils s’excluent d’eux-mêmes de l’espace public. D’abord, parce qu’on ne peut désigner par « public » (de publicus, publicum, « l’intérêt public ») d’une œuvre ceux qui refusent d’en prendre connaissance (ce qui relève de leur absolue liberté), alors même que l’œuvre est, précisément, en libre accès… public. Ils ne sont donc nullement empêchés par quelque autre public oppositionnel – au sens privatif qu’ils leur attribuent.
Ensuite, si, par ce refus, des personnes s’opposent, précisément, aux règles, codes et cadres des dominants d’un certain débat public, c’est sans tenir compte du fait que l’espace public n’appartient à personne : il est public, et le débat appartient à tous. Il ne saurait y avoir un débat « légitime » qui refuserait de prendre en compte les faits et, en particulier, de prendre connaissance de l’œuvre à critiquer. Cette légitimation, qui se prétend « de gauche », est l’exact pendant des positions d’extrême-droite, qui réclament aveuglément la censure des œuvres, dans une décision déterminée de refus de l’existence même de l’œuvre, donc de la voir, de l’entendre…
Ce refus qui prétend se fonder sur une (supposée) critique de l’œuvre est invalide puisque, par définition, celui qui la formule ne sait pas de quoi il parle. On ne peut à la fois se réclamer du débat démocratique et refuser qu’il ait lieu. Il faut au moins s’entendre a minima, et cela vaut a fortiori pour les expériences esthétiques des œuvres d’art, sur l’œuvre et ce dont elle parle. Pour cela, il faut la voir, en faire l’expérience, ce à quoi chacun est invité dès lors que l’œuvre est rendue publique.
Le refus de voir (ne serait-ce que le temps de l’expérience de l’œuvre) selon le point de vue de l’autre (l’artiste en l’occurrence) est parfaitement légitime en soi. Mais toutes les œuvres d’art proposent, par principe, un « autre regard ». Et surtout, pour pouvoir prendre position politiquement et oppositionnellement, encore faut-il savoir, c’est la relation esthétique minimale nécessaire, de quoi telle œuvre retourne.
On peut voir là les prémices d’une position qui s’est développée largement quelques années plus tard, opposant les partisans du débat démocratique autour des œuvres, qui peuvent prendre en compte les intentions de l’artiste, le contexte de la polémique, les prises de positions, mais aussi les réactions du public, son droit absolu au rejet et à la critique… et les partisans d’une opposition préalable, qui entendent se limiter à des critères fixes et prétendument objectifs qui ne demandent ni examen ni même une prise de connaissance de l’œuvre. L’incompréhension qui en résulte est devenue de plus en plus fréquente dans les affaires liées aux accusations de sexisme, de blackface ou d’appropriation culturelle.
Dans un texte publié dans AOC, Bérénice Hamidi Kim, sociologue du théâtre, revient sur ce qu’elle appelle pudiquement l’« interruption », en mars 2019 à la Sorbonne, de la représentation des Suppliantes d’Eschyle. En réalité, le spectacle a été empêché par des étudiants biberonnés aux théories abordées ici et par des associations, dont la Ligue de Défense des Noirs Africains (LDNA), voguant entre machisme, fascisme et antisémitisme, venue parader devant la Sorbonne à l’appel du CRAN, qui a fait monter les enchères en dénonçant le spectacle avant qu’il ait lieu, le qualifiant de raciste au motif que les comédiennes avait la peau teinte en couleur sombre, alors que ce maquillage avait été abandonné par le metteur en scène au profit de masques, eux-mêmes immédiatement accusés d’être également racistes… Il s’agit ici pour Hamidi Kim de légitimer le choix de s’affranchir du passage devant le tribunal pour avoir gain de cause. À partir d’une analyse partielle et partiale du droit, la sociologue légitime la censure en acte tout en déniant qu’elle en soit. Puisque la censure, c’est l’État…
Il n’est pas utile d’égrener les autres retournements rhétoriques – la liberté de création serait non pas une liberté individuelle, mais une liberté collective ; n’en jetez plus… – qui ont pour fonction systématique de tenter (bien maladroitement) de remettre en cause cette liberté désormais honnie.
Difficile, après cela, et pourtant nécessaire, d’en appeler au débat serein. Il est urgent que les artistes de toutes origines et de toutes formations aient accès aux lieux d’expression et de création et que cessent les actes de racisme dans les institutions culturelles françaises. L’Opéra de Paris y travaille et c’est une excellente chose. Les recommandations de Pap Ndiaye et de Constance Rivière sont bienvenues, y compris quand elles invitent à renoncer au maquillage comme signe racial [4].
Pour nous, il n’était pas question, pour autant, d’accepter que cette évolution se fasse au détriment d’une partie du répertoire, ou de la qualité et de l’enjeu, historique et esthétique, des œuvres. C’est pourquoi nous nous réjouissons qu’il soit affirmé dans ce rapport que « La lutte contre les discriminations ne peut pas se faire au détriment de la liberté de création » : tout doit pouvoir être joué, et il relève de la mise en scène et de l’accompagnement du spectacle que le public ne soit plus entraîné vers l’indulgence avec le racisme présent dans certaines œuvres.
Le rapport écarte l’attribution systématique des rôles concernés à des artistes racisés : un chanteur noir pour Othello, une chanteuse chinoise pour Turandot, etc., comme le fait le Royal Opera de Londres. Le risque serait alors d’assigner les artistes à certains rôles, de renforcer l’idée que la couleur de peau est un élément de choix déterminant dans l’attribution des rôles. Au contraire, comme le dit le metteur en scène David Bobée, nouvellement nommé à la direction du CDN de Lille (malgré une campagne de dénigrement orchestrée par des membres du Printemps Républicain, autre mouvement particulièrement favorable à la censure sous couvert de la dénoncer) : « Le véritable universalisme, c’est quand on se reconnaît dans une autre couleur de peau. »
Il est important que les polémiques s’apaisent, et elles ne peuvent s’apaiser que par la concertation et la discussion.
Dans une société démocratique, on doit pouvoir librement débattre de ce qui fâche, choque et est considéré par certains comme indigne. Nous ne pouvons, et le pouvons encore moins depuis les attentats qui nous ont endeuillés, accepter ces nouvelles censures, passages à l’acte contre les œuvres, qui vont de la protestation physique à la destruction de l’œuvre, les cas de vandalisme s’étant, dans la même période, démultipliés. Et nous savons, hélas, que l’exercice de la liberté expose parfois jusqu’à la mort. Une censure euphémisée, demeure une censure. Il y a donc une très grande urgence à retrouver la voie de la disputatio [5].