Que peut la littérature ? L’imagination des autres vies et le travail de « care »
La crise sanitaire qui se prolonge nous montre combien il est nécessaire de prendre soin les uns des autres et de défendre les activités dites de care. L’épreuve subie du confinement s’est imposée comme le Pharmakon moderne : à la fois remède à la propagation du virus et poison de l’isolement, elle a révélé la recréation permanente de frontières entre les un.e.s et les autres. Isolés, sommes-nous pour autant séparés ? En imagination, pouvons-nous nous reporter aux autres, à tous les autres ?
À défaut de fréquenter les salles de cinéma ou les théâtres pour se glisser dans d’autres vies, nous nous sommes emparés comme jamais des fictions. Est-ce là un hasard ? De quelle sorte d’expérience s’agit-il ? L’écriture fictionnelle, dans la littérature comme dans le cinéma, comme dans les séries, peut-elle se concevoir comme une expérience de pensée originale consistant à se mettre, par l’imagination, à la place des autres ?
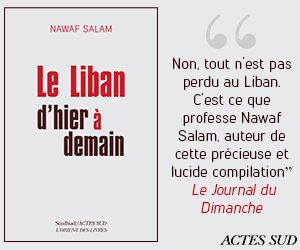
Nos vies sont tramées avec les autres vies : ainsi jusqu’où vont les autres, à l’intérieur de nous mais aussi à l’extérieur ? Si les personnages qui prennent forme dans la lecture ou dans la vision renvoient à des existences qui sont d’authentiques personnes (réelles ou fictives, peu importe), c’est parce qu’en retour les existences que nous sommes reprennent formes et contours à la faveur des personnages auxquels nous nous rapportons grâce à notre imagination.
La fiction appartient au monde qui est le nôtre ; elle est un mode d’existence pour Bruno Latour : « Dire que les êtres de fiction peuplent le monde, c’est dire qu’ils viennent à nous et qu’ils s’imposent, mais avec ceci de particulier qu’ils ont besoin néanmoins, comme Souriau l’avait si justement noté de notre sollicitude. Nous en formons, dit-il, le “polygone de sustentation” ! Leur statut propre, c’est que : “Le composé doit tenir tout seul”, comme disent Deleuze et Guattari. Mais si nous ne les reprenons pas, si nous ne les soignons pas, si nous ne les apprécions pas, ils risquent de
