La littérature, l’universel, le politique
Dans les attaques subies ces dernières semaines par certains courants nouveaux de la recherche et de l’université, des études de genre aux approches postcoloniales, la littérature a été bien souvent prise à témoin. Qu’il s’agisse de réfuter le droit à l’examen critique des conditions de traduction et de mise en scène, de s’interroger sur la responsabilité personnelle des écrivains ou collective des représentations, de disqualifier les écritures politiques ou féministes engagées, de s’inquiéter du singularisme et du différentialisme portés par les écritures contemporaines, une conception univoque, abstraite et absolutisée de la littérature, supposément celle des Lumières, mais en réalité née avec le nationalisme scolaire du XIXe siècle, est avancée par les défenseurs autoproclamés de l’universalisme « républicain » à la française.
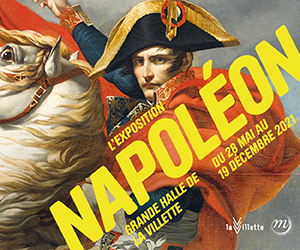
Ouvertement anti-libérale et anti-individualiste, Isabelle Barbéris, porte-parole des idées de l’Observatoire du décolonialisme en matière de culture, s’en prend ainsi dans L’Art du politiquement correct à la « privatisation de la représentation », aux « logiques séparatistes » de l’art contemporain comme à ses ambitions politiques qui ne conduiraient qu’à « parodier » l’exercice de la démocratie. Rapprochant la quête de « diversité » de pratiques « tribales », l’essayiste regrette la disparition de « l’ancienne autorité de l’œuvre d’art » et de « communautés interprétatives communes » au nom de la démocratisation culturelle.
Bergère de l’universel, la littérature devrait rester pure des débats et des intérêts des communautés humaines et se tenir dans une description à distance du monde, en alignant si possible la version du neutre qu’elle porterait sur les intérêts du mâle blanc européen. L’artiste, sacralisé par son rapport aristocratique à l’absolu, serait déclaré irresponsable, surtout s’il est coupable de pédocriminalité. La mondialisation par la traduction, processus supposé transparent et lui aussi pur de tout enjeu politiq
