Pas de garantie de l’emploi sans revenu garanti
La campagne « Un emploi vert pour tous ! » lancée en 2021 par l’Institut Rousseau et Hémisphère gauche, soutenue par plusieurs ONG écologiques[1], propose de généraliser l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) à l’échelle nationale pour créer un million d’emplois autour d’activités d’utilité sociale et écologique.
Dès le début, le revenu de base a fait figure d’épouvantail. Alexandre Ouizille et Chloé Ridel, porte-paroles de la campagne, ont publié dans Libération une tribune intitulée : « Pour une garantie de l’emploi et non un revenu garanti ». On ne pouvait faire plus explicite. Leur argument principal tenait dans une idée : « Le revenu universel n’est, finalement, qu’une forme de solde de tout compte de la société vis-à-vis de l’individu, une transaction monétaire qui vaut quitus[2] ».
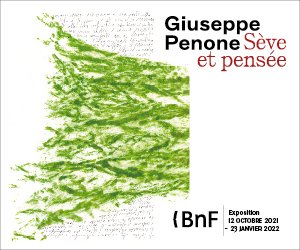
C’est ce même argument qui a été employé par Emmanuel Macron pour rejeter le projet d’expérimentation du revenu de base porté par 19 départements socialistes, évoquant lui aussi un « solde de tout compte » lors des annonces de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté le 13 septembre 2018. Pour lui, « au droit à l’accompagnement, doit correspondre un devoir, et il doit y avoir une sanction si tel n’est pas le cas[3] ».
Le revenu de base, traduction de basic income qui constitue la terminologie admise au niveau international, même si les étiquettes sont foisonnantes, est défini de manière idéal-typique par Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght comme « un revenu en espèces, payé régulièrement à tous, à titre individuel, sans conditions de ressources ni obligation de travailler[4] ». Bien sûr, cette définition générique connaît des aménagements selon les doctrines, les programmes et les expérimentations qui s’y rattachent.
En toile de fond des débats entre garantie de l’emploi et revenu garanti, c’est bien la question des politiques d’activation des dépenses sociales qui est soulevée. L’activation vise à la fois
