Leçons politiques chiliennes pour la gauche
Un peu avant que la pandémie de SARS-CoV-2 ne rende les rassemblements de foules dangereux et prohibés, la planète a été parcourue par une vague de manifestations de masse réclamant de leurs dirigeants qu’ils se soumettent aux exigences de la démocratie ou « dégagent » – du Soudan au Chili, de l’Algérie à Hong Kong, du Mali au Liban, de la Tunisie au Bélarus.
La plupart de ces mobilisations de rue se sont assez mal terminées, brisées par la répression implacable de pouvoirs irascibles ou l’indolence de dirigeants dépassés par la profondeur des ressentiments. Une seule d’entre elles s’avère être, pour le moment, une success story : celle du Chili. C’est une histoire en trois actes.
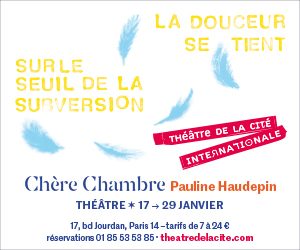
Le premier a eu lieu en 2019, quand une longue et violente révolte populaire a forcé un gouvernement aux abois à se plier à la demande de protestataires que la violence débridée des forces de l’ordre n’a pas réussi à mater : rédiger une nouvelle Constitution qui mette un terme à l’ordre libéral instauré par le général Pinochet en 1981 et que les gouvernements dits « de transition » qui se sont succédé depuis son éviction du pouvoir en 1990 n’avaient jamais osé révoquer. Devant la résolution de la population, le Président Sebastián Piñera concède alors, par stratégie ou par cynisme, la convocation d’une Assemblée constituante composée de 155 personnes élues au suffrage universel, respectant la parité entre hommes et femmes et réservant 17 sièges pour les représentants des peuples autochtones.
Le deuxième acte s’est déroulé en mai 2021, à l’occasion du scrutin désignant les membres de cette Assemblée et auquel 40 % du corps électoral a participé. Cette consultation a réservé trois surprises.
La première a été que l’union de la droite et de l’extrême droite (Vamos por Chile) n’est pas parvenue, avec près de 20 % des voix seulement, à obtenir le tiers des sièges de cette Assemblée que les sondages lui prédisaient et qui lui aurait permis de rendre caduque la nouvelle Constitution qui
