Bonne année tout de même !
La période de vœux se termine. J’aime la tradition des vœux de début d’année qui me donne l’occasion de faire un signe à tous ceux que je ne vois pas assez et de leur redire mon affection. J’ai compris aux réponses reçues cette année qu’il pouvait sembler incongru d’adresser des vœux : « malgré la situation terrible dans laquelle nous vivons… », « comment souhaiter une bonne année dans une telle situation… », « malgré tout et en espérant que les choses s’arrangent… », « j’ai du mal avec les vœux en ce moment… », etc.
Il n’était question que de la « situation générale » derrière laquelle disparaissent nos vies.
Troublé, je me suis interrogé sur ce qui lie la politique et nos vies et ce qui l’en sépare.
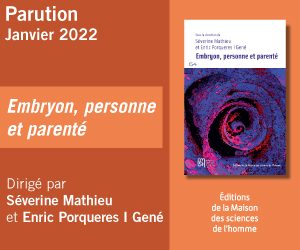
Je me suis demandé pourquoi ces proches qui vivent, comme moi, le plus souvent dans un confort matériel à peu près assuré, sans vivre de drame personnel en raison du Covid, me répondaient comme si le virus les affectait personnellement, comme si la défaite annoncée de la gauche à la prochaine élection présidentielle allait modifier profondément leur situation propre, comme s’ils étouffaient déjà en raison du réchauffement de la planète, comme si la précarité qui frappe une partie importante de nos concitoyens était la leur ?
Pourquoi ces proches qui pensent comme moi que la politique est devenue un cirque de bien mauvaise qualité (le dernier dans lequel les bêtes ne sont pas interdites), qui ont constaté l’incapacité des responsables politiques de gauche ou de droite à faire ce qu’ils ont promis, considèrent-ils que leur vie dépend du prochain scrutin présidentiel ?
Nous ne vivons pas que de politique et nous pourrions, comme beaucoup, vivre sans trop nous soucier de ce qui se passe dans ce champ clos d’affrontements de partis politiques évanescents. Nous pourrions faire sécession en quelque sorte, comme le fait déjà une bonne partie de la société.
Les riches ont donné le signal dans les années quatre-vingt avec la contre-révolution libérale.
Les jeunes génér
