Jouissance cognitive et jeu électoral : fin de partie ?
Nature humaine et addiction cognitive
Avant d’en venir au jeu électoral, commençons par poser les données anthropologiques. La vie animale, dont participe l’être humain, est régie par le système biologique des récompenses chimiques. L’animal, pour faire face à la nature où il est immergé et pour réagir efficacement au cours des multiples interactions qu’il a avec son environnement, doit constamment mettre en œuvre ses capacités cognitives et il en est récompensé, non seulement en parvenant à surmonter ces difficultés imprévisibles et toujours renaissantes, mais par les « récompenses chimiques » qui sont produites naturellement par son appareil neuronal et dont les plus connues sont la dopamine, la sérotonine ou l’endorphine.
Ces capacités sont vitales pour l’animal et il passe donc la première phase de sa vie à les développer, grâce à des phases de jeu pendant lesquelles, sous la surveillance d’adultes (la mère, le plus souvent), il a pu s’exercer en toute liberté et jouir de cette insouciance ou optimiser ces capacités. Mais cette pure jouissance, éprouvée à l’écart des interactions dangereuses avec la nature, cesse avec l’autonomie de l’âge adulte. L’animal est alors lancé dans la vie réelle ; ses plaisirs, aussi intenses soient-ils, seront désormais limités du fait même des menaces ou des difficultés qu’il rencontre à chaque moment de son existence.
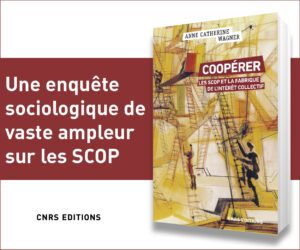
Ce système de récompense neuronal, l’être humain le partage à peu près totalement avec le reste des mammifères. En revanche, il est le seul animal auquel son évolution phylogénétique a appris à déconnecter le plaisir cognitif de sa fonction vitale. C’est par exemple ce qui lui permet de rire : face à quelque chose d’incongru, qui pourrait l’inquiéter, il éclate de rire, parce qu’il sait qu’il n’a rien à en redouter, comme si une frontière invisible et infranchissable le séparait de l’objet de son rire, comme s’il était capable de se déconnecter de son environnement et des menaces qui peuvent en surgir.
C’est pourquoi Rabelais disait, en s’appuyant sur l’autorité d’Aristote, que le rire était le propre de l’homme – même s’il existe des manifestations animales du rire. Au passage, je reconnais qu’il est très imprudent de prétendre, comme je viens de l’écrire, que l’homme est « le seul animal » à avoir cette aptitude à la déconnexion cognitive ou, d’ailleurs, à avoir quelque aptitude que ce soit : disons que l’homme est l’animal chez qui cette déconnexion cognitive est la plus forte ou, du moins, la plus manifeste ; après tout, on ne sait pas ce qu’il se passe dans la tête d’un animal. Mais c’est une autre question.
Revenons à la jouissance cognitive : elle permet d’exercer ses capacités pour elles-mêmes, pour le seul plaisir de les éprouver en soi et sans la limite qu’imposerait la constante attention à une menace extérieure. Grâce à elle, l’être humain peut tout à loisir élaborer des scénarios imaginaires, raisonner, créer, éprouver sa force physique (en pratiquant un sport, tout simplement) – et, de façon plus générale, projeter librement son imagination vers un futur immédiat ou lointain, à chaque moment de sa vie et dans chacune de ses activités.
Cette aptitude exceptionnelle à la jouissance cognitive, l’être humain l’a sans doute développée parce que la période de l’apprentissage, donc de la pratique ludique, est chez lui beaucoup plus longue, avant l’arrivée à l’âge adulte, que chez tous les autres animaux (même chez les autres primates) : tout se passe comme s’il avait été dopé au plaisir ludique et qu’il ne pouvait plus s’en priver.
Car le jeu est la matrice de cette jouissance si intense, produite par le libre exercice des facultés cognitives. Il y a de multiples variétés de jeu et autant de manières de le définir. Mais, dans tous les cas, il dépend d’une condition absolument nécessaire : le plaisir ludique ne doit faire courir aucun risque réel (ou, du moins, pas assez grave pour interrompre la pleine libération du plaisir). En revanche, s’il est impératif que le joueur n’ait à craindre aucune perte grave, il peut gagner beaucoup ; le gain lui est même nécessaire pour prouver sa réussite et vérifier ses aptitudes. Le jeu tient précisément dans ce déséquilibre entre l’espérance de succès et l’absence de danger. C’est le principe aussi du jeu d’argent : on peut y faire fortune, mais on n’y perd éventuellement que son enjeu – sauf chez les joueurs dont la compulsion ludique est arrivée à un stade pathologique. C’est précisément à la fois pour formaliser la victoire et limiter les conséquences de la défaite que le jeu est limité dans le temps et encadré par des règles, qui, non seulement en fixent le déroulement, mais le préservent de toute contamination entre le plaisir ludique et le monde réel.
Or ce plaisir, n’étant plus limité par la menace du risque, est naturellement poussé à une expansion incontrôlable. N’étant plus seulement le moyen d’une interaction efficace avec un environnement menaçant, il devient la finalité même de l’action. La gourmandise est l’addiction de celui qui s’adonne au plaisir de manger sans l’aiguillon de la faim. De même et à une échelle infiniment plus grande, l’être humain est devenu cet animal shooté à la jouissance cognitive, dans une société qui ne cesse d’en multiplier les formes addictives (les jeux en tout genre et, bien sûr, toutes les drogues psychotropes, mais aussi le sexe, le travail, le sport, les médias, etc., etc.) – quitte à devoir ensuite en soigner les formes les plus nocives.
L’invention du jeu démocratique
Pour autant qu’il soit possible de le savoir, la première manifestation culturelle de cette addiction fut, aux temps préhistoriques, l’apparition de pratiques religieuses : que l’on parle d’animisme ou de toute autre forme de croyance, il s’agit surtout, pour le groupe social, d’entretenir l’espérance d’une relation privilégiée avec une sphère supranaturelle grâce à laquelle il peut s’abstraire à tout moment, au moins virtuellement et en pensée, de sa confrontation avec une réalité immédiatement menaçante, à commencer par celle de la nature imprévisible et sauvage.
Puis il y eut ce que l’on appelle « la révolution du néolithique » qui, de quelque façon que l’on se la représente avec les très minces indices que nous en avons, a permis à des sociétés humaines d’échapper à l’aléa de la chasse et de la cueillette, de programmer l’accumulation de sa subsistance, de s’organiser collectivement – puis, progressivement, de hiérarchiser le groupe, de prévoir sa protection contre l’agression d’éventuels concurrents. Beaucoup d’anthropologues ont souligné que cette vie d’agriculteurs était bien plus pénible que celle des chasseurs-cueilleurs à laquelle les hommes renonçaient ainsi : mais cela prouve justement que le plaisir de la libre cognition était si intense qu’il justifiait tant de désagréments – dont le moindre n’était pas la désagrégation de la société égalitaire des chasseurs-cueilleurs.
Cependant, ce plaisir d’imagination projective (appelons-le ainsi) était essentiellement celui du chef, auquel chacun devait obéir, en fonction de son positionnement hiérarchique. Concrètement, la plupart des membres du groupe devaient se contenter de suivre en partie les ordres reçus, en partie les règles coutumières, tacitement acceptées et appliquées de temps immémorial. Une étape décisive, dans cette application à l’organisation collective (donc à la politique) du plaisir cognitif, fut donc l’invention de la « démocratie », dont on attribue le mérite à l’Athènes antique (mais peu importe) : j’en arrive enfin au sujet que promettait mon titre.
Cette « démocratie », qui a pris à Rome la forme d’une « république », reposait sur deux principes. D’une part, la projection politique (avec les choix que cela implique) découlait de la délibération collective (et non plus des simples rapports de force ou d’une autorité imposée) : l’espace public du débat fonctionnait désormais comme un vaste terrain de jeu délibératif auquel tous les citoyens mâles participaient. D’autre part, comme dans tout jeu, la partie était limitée dans le temps par l’élection d’un maître du jeu (« stratège » à Athènes, « consul » dans la république romaine) qui organisait la partie pendant le temps de son mandat ; ainsi, les perdants de la veille pouvaient toujours espérer devenir les gagnants de la partie suivante, ce qui est une condition sine qua non du plaisir ludique.
Cependant, celui-ci était en vérité drastiquement restreint par le fait que la pratique politique consistait souvent à délibérer de l’attitude face à des voisins hostiles. La menace de la guerre, analogue aux risques naturels pour l’animal sauvage, suspendait ipso facto l’innocuité consubstantielle au jeu, si bien que, de fait, le recours à un chef de guerre s’imposait vite comme la solution la plus expédiente : la démocratie grecque a laissé la place à Alexandre le Grand, la république romaine à César.
Voilà les principes, qu’il fallait rappeler. Mais laissons passer un ou deux millénaires, et venons aux temps modernes, où, progressivement, à partir du XVIIe siècle, s’est à nouveau mis en place, à l’initiative de l’Occident, un jeu démocratique, reposant cette fois sur le système représentatif. Cette variante moderne se déroule en deux phases. Pendant la première, qui intervient à intervalles réguliers et suffisamment rapprochés, le public joue à élire ses représentants, réunis en assemblée et se choisissant un chef. Souvent aussi, pour que la partie soit plus excitante, le public élit lui-même celui qui sera le chef : c’est le système qui est en vigueur en France depuis 1962.
Dans ces moments électifs, le plaisir du jeu consiste pour les uns à élaborer en toute liberté des scénarios et à imaginer des stratégies, pour les autres à en discuter : on nomme programmes ces scénarios et ces stratégies. En revanche, dans la deuxième phase (la plus longue), le public ne participe plus directement au jeu (au contraire de la démocratie directe des Athéniens) ; mais il a le plaisir d’y assister en spectateur, comme il le fait pour de nombreux autres jeux (théâtre, sport, etc.). Cette jouissance démocratique est d’autant plus intense qu’elle est périodique (rien n’est plus agréable qu’un plaisir attendu, dans lequel on se projette à l’avance). À chaque début de partie (ou élection), le jeu repart donc de zéro en fonction du scénario choisi dans sa première phase, et le chef élu commence à jouer en fonction du projet qu’il a su faire partager : c’est ce que l’on appelle, en France, l’état de grâce.
Bien sûr, ce jeu n’en est pas vraiment un, parce que l’espace ludique se confond avec le monde réel et qu’il ne dispose pas cette frontière conventionnelle qui devrait le protéger. Donc, inévitablement, le plaisir du jeu s’atténue peu à peu, les joueurs se frottent au réel et sont perturbés dans leur mise en œuvre des règles programmatiques, les spectateurs sont eux-mêmes perturbés par les inquiétudes face à tout ce qui survient en dehors du jeu, l’état de grâce se termine ; bref, la déception et la lassitude s’immiscent. Cela ne prouve d’ailleurs pas la faillite du jeu électoral, au contraire : chacun est d’autant plus impatient de recommencer une partie, de réinventer des scénarios, de remobiliser librement son imagination projective ; la démocratie élective offre l’avantage inestimable de recréer, à volonté et à intervalles réguliers, les conditions concrètes du plaisir ludique.
Il est d’ailleurs possible, pour distraire le public et relancer son intérêt, d’introduire des phases ludiques à l’intérieur du jeu principal. C’est la fonction, aux États-Unis, des élections intermédiaires au Congrès, à mi-mandat du président. La France, qui a choisi de procéder successivement à l’élection présidentielle et aux élections législatives, n’offre pas cette possibilité ; on y est d’autant plus impatient de recommencer la partie – avec cette frustration permanente que le deuxième jeu (législatif) ne se joue pas vraiment selon les règles, n’étant que la conséquence mécanique du premier (présidentiel).
D’un jeu l’autre
Mais ne nous y trompons pas. Les défauts éventuels des règles n’ont qu’une influence secondaire. Tous les systèmes ont leur défaut. Mais si l’on prenait encore plaisir à jouer, on s’accommoderait sans peine de mauvaises règles : le mécanisme électoral des États-Unis est l’un des moins satisfaisants qui soient, et cela n’a pas empêché à la démocratie américaine de servir longtemps de modèle. La vérité est que, dans plusieurs pays occidentaux, le jeu électoral est manifestement grippé, comme le montrent à la fois l’augmentation continue de l’abstention et la séduction nouvelle que le fantasme du chef exerce auprès d’opinions publiques déboussolées. La raison en est que les trois conditions indispensables au plaisir ludique ne sont plus aussi bien remplies.
La première, rappelons-la, est que le jeu suscite de véritables espoirs de gain : c’est l’espérance de cette réussite finale (aussi symbolique soit-elle) qui permet le plaisir projectif. Or un soupçon, apparu dans les marges les plus radicales de la contestation politique, s’est maintenant massivement installé dans l’esprit des spectateurs du jeu politique : ceux-ci pressentent que ce jeu n’est qu’un leurre, que rien ne s’y gagne réellement, qu’il ne s’agit que d’un simulacre fait pour amuser la galerie et cacher les deux jeux, articulés entre eux, qui l’ont remplacé : le jeu financier et le jeu technocratique.
Le jeu démocratique serait ainsi devenu un semblant de jeu, qui ne mérite même plus qu’on s’en divertisse. Selon son principe initial (disons dans l’Angleterre marchande de la fin du XVIIe siècle), la démocratie représentative allait de pair avec le libéralisme économique, les deux se confortant l’un l’autre. Mais tout se passe comme si les deux mécanismes s’étaient dissociés, le capitalisme ne voulant dépendre que de sa seule rationalité et laissant la démocratie doucement péricliter. De là, par exemple, la protestation violente des gilets jaunes.
La deuxième condition est l’innocuité du jeu. Que les uns ou les autres gagnent, on pensait confusément que tout pouvait se rattraper à la partie suivante, puisque (c’est le principe du jeu) l’on recommençait toujours à zéro. C’était d’autant plus facile à croire que, dans le monde occidental, tous les pays jouaient le même jeu et que, pour les pays qui, en dehors de cette sphère, ne le pratiquaient pas, on pensait qu’ils étaient seulement en retard et qu’ils devraient s’y mettre un jour ou l’autre.
Or l’affaiblissement, relatif mais inéluctable, de ce modèle occidental et le retour au premier plan de grandes puissances mondiales restées le plus souvent en dehors de ce jeu démocratique (à commencer par la Chine) ont brutalement changé la donne et suscité une inquiétude grandissante : et si le jeu rendait aveugle aux dangers réels ? Et si l’urgence exigeait d’arrêter le jeu démocratique (par exemple, en cherchant le salut dans tous les populismes autoritaires renaissant un peu partout) ?
À l’opposé, l’aggravation continue des dangers écologiques rend de plus en plus dérisoire la succession stérile des parties électorales et fait parfois désirer l’exercice plus rationnel d’un pouvoir scientifico-technocratique ou, au contraire, une libération des initiatives particulières dans le cadre de communautés conçues selon un idéal plus ou moins anarchisant.
La troisième condition est le strict cantonnement de l’espace de jeu, afin que celui-ci ne déborde pas sur le monde réel ni ne soit contaminé par lui. Or l’espace du jeu démocratique, sous sa forme occidentale, reposait sur un étagement à deux niveaux. D’abord, l’espace de l’exercice politique, réservé à des institutions dédiées ; ensuite, l’espace dévolu au public des spectateurs, le lien entre les deux niveaux étant assuré depuis l’origine par la presse, dont la première mission historique, depuis l’Angleterre du XVIIe siècle, a été de représenter au-dehors le spectacle du jeu démocratique. Mais le développement prodigieux de nouveaux médias a progressivement changé la donne, en déplaçant le jeu démocratique de son espace institutionnel vers le terrain médiatique.
Plus récemment, l’apparition des réseaux sociaux a permis à l’ancien public des spectateurs de devenir à son tour acteur – qui plus est, acteur d’un jeu brutal dont les règles sont devenues très confuses. On assiste donc à une dérégulation forcément inquiétante de la pratique ludique, à une confusion systématique entre l’espace ludique de la politique et l’espace privé, en fin de compte à l’importation de comportements totalement anomiques. En bref, le jeu démocratique n’en est plus un, puisqu’il n’y a plus de terrain ni de règle nettement définis.
La conséquence logique de tous ces bouleversements, dont les effets sont spectaculaires aujourd’hui mais qui, comme toujours, ne constituent qu’une étape dans un processus de très longue durée, est l’enrayement, manifeste et sans doute persistant, du jeu démocratique tel qu’il s’est fixé jusqu’à présent et dont les dernières élections présidentielles, en France, montrent le délitement.
Cependant, au moment de conclure, il faut ajouter aussitôt que c’est beaucoup moins grave qu’on le prétend. Car les esprits pessimistes, les yeux toujours fixés sur une actualité immédiate dont ils extrapolent des leçons exagérément historiques, oublient que notre jeu démocratique est lui-même extraordinairement récent et local.
Récent, d’abord : après tout, l’Église catholique, représentant alors la religion très largement majoritaire en France et soutenue par la droite conservatrice, ne s’est résigné à accepter officiellement le fait républicain qu’en 1892, avec l’encyclique Au milieu des sollicitudes. Il y a à peine plus d’un siècle – c’est-à-dire à peu près rien, au regard de l’histoire. Et d’ailleurs, depuis ce temps, il n’y a pas eu de décennie sans qu’une crise majeure, avec son lot de violences, n’ait fait prédire, pour une raison ou pour une autre, l’effondrement de l’édifice. C’est inévitable : le jeu démocratique, n’étant qu’un jeu, est structurellement inadéquat au réel. À ceci près qu’il fait lui-même partie de notre réalité, si bien que l’on a toujours fini par s’en accommoder, tant bien que mal.
Très local, ensuite. On a beau, peut-être avec raison, en défendre la vertu universelle, il n’empêche que son invention est intimement liée à l’Occident et à sa phase d’expansion impérialiste. Il n’est donc pas raisonnable de penser que, à l’ère du village planétaire, de la mondialisation généralisée et de la reconnaissance légitime de toutes les altérités, le jeu politique ne finisse pas, à plus ou moins long terme et sous des formes aujourd’hui imprévisibles, à s’adapter aux transformations accélérées que nous connaissons, sur fond d’urgence climatique et de catastrophes écologiques.
Mais une chose est certaine : nous continuerons à jouer, car nous y prenons trop de plaisir cognitif pour y renoncer et il est dans notre nature animale d’en recréer les conditions, quoi qu’il arrive.
NDLR : Alain Vaillant a fait paraître en septembre 2021, aux Éditions Le bord de l’eau, L’anthropocène ou l’âge de l’addiction cognitive.
