Le blanchiment des images
Monoculture de l’image
Les photographies de banques d’images ou images de stock[1] tapissent tout notre univers visuel. Elles recouvrent les murs des villes, des transports, des écrans, des médias. Elles nourrissent les films les plus divers, les documentaires à la télévision, les publicités, les magazines, les rapports annuels d’entreprises, les articles « pièges à clics », les packagings alimentaires, les emballages de produits high-tech, les emails, les mèmes, les cartes de vœux personnalisées, les bâches de chantiers, les flancs des voitures de location…
Au début du XXIe siècle, les images de stock sont soudain devenues ubiquitaires. Avec la diffusion en ligne et l’apparition de portails low cost – ou « microstocks » – tels que Shutterstock, iStockPhoto, Dreamstime, Fotolia ou Bigstockphoto[2] –, les catalogues grossissent dans des proportions inédites[3]. Les photographies, dessins, modélisations 3D et vidéos[4] sont produits à la chaîne et vendus à prix cassés (à partir de 25 cents). Leur utilisation massive les rend omniprésentes dans nos vies.
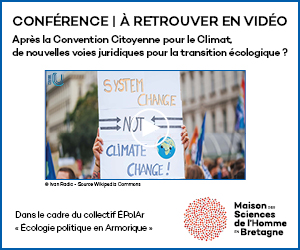
En 2021, le leader du marché, Shutterstock, propose plus d’un milliard de médias, dont 315 millions de photographies, un très grand nombre de vidéos, d’illustrations et de pistes sonores. Ces chiffres impressionnants sont atteints grâce au même système de plateforme qui est à l’origine du succès d’Uber, Airbnb ou Deliveroo et qui généralise le travail à la tâche – ou « tâcheronnisation ».
L’artiste Aniara Rodado désigne par l’expression « technologies hégémoniques[5] » des systèmes – qui ne sont pas nécessairement digitaux, ni machiniques – qui s’imposent à tous et partout, au détriment d’autres formes de médiation. Par leur diffusion et leur utilisation massive, les banques d’images appartiennent manifestement à cette catégorie : il est donc nécessaire d’observer plus en détail le monde qu’elles dépeignent.
Les images de stock semblent couvrir tous les champs du possible. Elles peuvent illustrer des situatio
