Du sens de l’État
La dernière des prévisions fausses en était à peine une, c’était plutôt un espoir collectif qui n’a pas eu le temps de prendre forme, même comme espoir : celui d’une « belle époque » d’insouciance, de progrès et de liberté, après les années d’épreuve imposées par la pandémie. Alors même que dans l’Histoire il n’y a jamais eu de « belle époque » que rétrospectivement, c’est-à-dire située non seulement après une guerre (celle de 1870-71) mais aussi avant une autre (celle de 1914-18), celle que nous avons presque inconsciemment projetée dans un futur proche n’aura pas trouvé un instant où se loger : nous ne sommes pas sortis de la pandémie que nous sommes déjà entrés « dans » la guerre, ou plutôt dans l’énigme de ce que peut vouloir dire « être dans la guerre ».
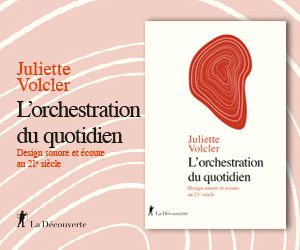
Car si les Ukrainiens en font l’expérience dans toute sa dureté depuis l’invasion russe, cette guerre se caractérise avant tout par l’indétermination de son champ : on ne sait où et quand s’arrêteront ou seront arrêtés les Russes et ce conflit non-déclaré, à la fois dans et hors d’Europe, laisse aussi dans le vague l’implication d’un nombre considérable d’autres puissances. Ce non-savoir signifie ici incommensurablement plus que l’incertitude : il change la manière de gouverner, sa relation à la technique (de soin comme de destruction), sa relation à ce que nous nommons encore des « peuples ».
L’enchaînement de la pandémie à la guerre, qui tient tout autant de l’emboîtement, d’un cruel ajout sans substitution, n’a en effet pas seulement été imprévisible : il a été, il est encore, celui de deux événements qui contiennent au cœur de leur déroulement, ou si l’on veut, dans leur logique même, l’impossibilité de toute prévision, et en ce sens, relève de la même logique.
Les techniques de pointe permettant de séquencer le virus et de produire des vaccins en un temps record ont contrasté avec le non-savoir politique.
Le temps où les gouvernements et les médias, en Europe et ailleurs, pouvaient affirmer que l
