Prendre position (politique) et prendre le temps (de regarder)
Cher Enzo Traverso,
Je vous écris avec des sentiments divisés, d’amitié et de reconnaissance d’une part – un peu de désagrément, voire une certaine irritation de l’autre. Lorsque s’est ouverte au Jeu de Paume, à Paris, l’exposition Soulèvements en 2016, j’ai été l’objet de quelques critiques, ce qui était bien légitime pour un tel exercice (et pour une telle thématique). Je n’ai pas pensé qu’il me fallait répondre à celles qui manifestaient ce sectarisme dont le débat intellectuel français est si souvent le théâtre, celui des inutiles affrontements entre personnes qui devraient pourtant se situer du même côté, comme on dit, de la barricade.
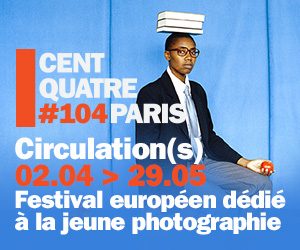
Une critique venant de vous, c’est tout autre chose parce que votre travail, depuis longtemps, m’importe – par le biais, notamment, de penseurs que nous admirons tous deux, et cela va de Walter Benjamin à Daniel Bensaïd ou Michael Löwy –, m’aide et me semble donc, sur plusieurs plans, fraternel.
Je vous suis reconnaissant, tout d’abord, pour ce que votre dernier livre Révolution : une histoire culturelle[1],a décidé d’entreprendre. Voilà en effet un chantier qu’il fallait renouveler, et dont votre contribution va sans aucun doute marquer, par son ampleur, une étape significative. Il n’entre pas dans mon propos de faire une liste de tout ce qui pourrait légitimement m’y donner à réfléchir ou, plus spécifiquement, pourrait nous rapprocher à travers nos essais respectifs sur ce genre de questions.
Il me suffira de rappeler que le point de vue, nommé par vous « histoire culturelle », consonne tout à fait avec mes tentatives issues de la Kulturwissenschaft d’Aby Warburg : une discipline ou « transdiscipline » qui avait débouché sur le projet d’une « iconologie politique » et que le travail d’Horst Bredekamp, dont vous vous réclamez dès le deuxième paragraphe de votre livre, a su prolonger de façon remarquable.
Vous repartez ainsi de l’idée, exprimée récemment par Bredekamp, que « les images nous observent[2] », une idée qui
