Traces – pour une psychanalyse à venir
«Traces » est un vocable – il y en aurait d’autres – qui offre la chance de penser la relance, urgente, de la psychanalyse. Cette psychanalyse-là que, depuis quelques années, je n’appelle jamais autrement que psychanalyse à venir. La lier strictement, dans la lettre de son nom, la psychanalyse, à l’à venir, est une façon de la distinguer aussi radicalement que possible de tous les discours réactionnaires contemporains, discours que l’on se permet de tenir en son nom bien souvent et qui, à chaque fois que c’est le cas, m’affligent. Ainsi, lui donner ce nom signifie toujours en même temps qu’une psychanalyse décliniste ou réactionnaire n’a jamais rien à voir avec ce que c’est que la psychanalyse, et ce depuis avant même sa date de naissance officielle. Je reviendrai à sa préhistoire, car Freud y aura tout de suite investi beaucoup et, par là même, y aura laissé des traces précieuses qui ne demandent qu’à être revivifiées – c’est précisément cela une trace mnésique. Immédiatement un branchement s’impose entre « traces » et « à venir ».
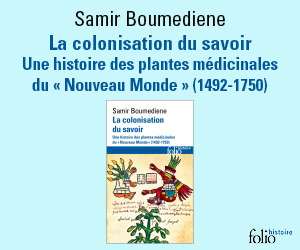
« Traces » n’est jamais le nom de je ne sais quel tropisme pour ce qui fût, de je ne sais quelle nostalgie, attachement viscéral au passé, et de je sais trop bien quelle pulsion réactionnaire non plus. Traces, au contraire, ouvre la venue de ce qui vient dans la rencontre, de ce qui travaille du passé dans le présent, de ce qui hante et meut ce présent qui, ainsi habité n’est ou ne peut jamais être pur présent. On aurait raison de penser là et au travail incontournable de Georges Didi-Huberman avec les « survivances » de Warburg – entre autres – et à la grande et révolutionnaire notion d’après-coup conçue par Freud, car, comme son nom l’indique, après-coup, c’est déjà l’à venir.
La seule écoute possible se fait depuis le non-savoir de la venue de ce qui vient.
À venir signifie non pas simplement futur, mais ce qui vient, à savoir la venue du venir et donc ouverture par ce qui surgit, effracte, disrupte, arrive. Une psychanalyse à venir est toujours une psychanalyse dérangée, inquiétée, intranquille, jamais sûre de son bon droit, partant, ayant à inventer du savoir sans arrêt. Ici est la matière et la concrétude même de la psychanalyse à venir et la chose est politique en diable. Si l’on pense à ce que signifie la seule demande que peut faire l’analyste à l’analysante ou à l’analysant – « règle fondamentale » est le nom de cette unique demande –, le politique ne peut manquer de venir à l’idée. Demander à l’analysante ou à l’analysant d’associer librement – ce que Lacan traduit très justement dans le séminaire Encore, par demander à l’analysante ou à l’analysant de dire « n’importe quoi » et il est terriblement difficile de dire n’importe quoi, voire impossible – c’est être obligé à l’accueil de ce qui vient sans aucun choix, aucune décision, aucun tri et donc aucun savoir a priori de ce qui arrive.
La seule écoute possible se fait depuis le non-savoir de la venue de ce qui vient. Si l’on savait a priori ce qui arrive, il n’y aurait rien à écouter dans ce qui vient de la parole adressée. Ce qui met également et immédiatement l’écoute du côté de l’insu, autre nom, nom plus ajusté à la chose, de l’inconscient. Je cherche ce que pourrait être une oreille inconsciente de l’analyste voire comment écoute l’oreille inconsciente de l’analyste. Il existe, à ce sujet, un hapax dans le corpus freudien. Il s’agit d’une lettre à Binswanger. L’on y trouve une fois et une seule fois cette proposition-là d’une oreille inconsciente. La chose n’y est pas dépliée mais je m’y appuie afin d’essayer d’écrire la théorie de cette écoute (pour la psychanalyse à venir), je la prends comme l’ouverture d’un passage à creuser pour la pensée, là même où la béance théorique dans le corpus analytique est étonnante. Le 22 novembre 1925, Freud écrit à Binswanger :
« Cher Docteur ! (…) Ma proposition d’appréhender l’inconscient de l’analysant avec son propre inconscient, lui tendre pour ainsi dire, l’oreille inconsciente comme un récepteur, a été formulé dans un sens modeste et rationaliste ; mais je sais qu’elle dissimule d’autres problèmes importants. Je voulais simplement dire qu’on devait se libérer de l’intensification conscientes de certaines attentes, donc créer le même état en soi que celui exigé de l’analysant. (…) »
Je rêve là d’une longue et double digression. D’une part afin d’insister sur ceci qu’à prendre Freud à la lettre, on comprend que c’est l’écoute qui appelle la parole. Que l’écoute et l’oreille font parler la parole. Il n’y aurait donc de parole, de langue et de langage qu’à la condition de l’écoute. L’oreille appelle la langue.
D’autre part (mais toujours selon cette condition de l’écoute inconditionnelle), pour insister sur la difficulté du dire « n’importe quoi ». C’est là que l’on comprend l’incroyable hypothèse de Freud, celle qu’il nomme lui-même « hypothèse de l’inconscient ». En effet, avec cette hypothèse et cette demande impossible du dire n’importe quoi, il vient troubler, déranger, inquiéter le logos lui-même et le principe fondamental sur lequel il repose – inquiéter le logos, c’est inquiéter tout ce sur quoi repose l’histoire de la pensée occidentale, soit la pensée occidentale comme telle. Je parle au moins du principe de non-contradiction. Demander le dire n’importe quoi à celle ou à celui qui vient être écouté.e, c’est en même temps demander l’au-delà du principe de non-contradiction. Aristote, dans sa Métaphysique, affirme que ne pas obéir au principe de non-contradiction c’est ne se rendre pas différent d’une plante. Or l’inconscient freudien, c’est l’au-delà du principe de non-contradiction. Et la demande faite à l’analysante ou à l’analysant est la transgression de l’ordre du logos, du principe, de l’archè, du commandement fondamental. On en déduira que la psychanalyse est l’attention à ce que l’on aura toujours, jusqu’à elle, considéré comme indigne d’écoute : traces, restes, rebuts, presque rien, marges.
Pour la psychanalyse à venir, « traces » est fondamental car c’est sur ce mot que repose et ce qui peut se penser au nom de la psychanalyse, et la psychanalyse elle-même. Même en son absence manifeste, mais manifeste seulement. Ainsi l’hyper complexité de la trace peut commencer à se dévoiler : elle n’a pas besoin d’être-là pour que joue l’effet de son tracé ou de sa passée. Le présent comme présence à soi-même est radicalement bousculé par les traces telles qu’elles auront été pensées dès avant l’origine de la psychanalyse. Qu’il n’y ait pas de « elle-même » ou de « comme telle » de la psychanalyse tient à la prégnance des questions que posent les traces et qui habitent sa pensée depuis avant sa naissance. « Traces » est le nom d’un opérateur puissant de désidentification, de dérangement, de déposition, de destitution, de distorsion, de désaliénation et, partant, de mouvements et de déplacements incessants, interminables.
(Cette interminabilité du mouvement – d’où peut-être le bien nommé mais mal entendu nom de « mouvement psychanalytique » – pourrait bien mettre en lumière ceci que la psychanalyse est en conflit permanent avec et dans ses propres institutions. Instituer ne peut pas ne pas figer. Si la psychanalyse est mouvements et déplacements, elle ne peut se laisser figer. Lorsqu’elle se laisse figer dans ses propres institutions, peut-être n’est-elle plus psychanalyse. Cette aporie n’est pas une petite chose. Politiquement le problème ne cesse et n’aura cessé de se poser avec tous les mouvements révolutionnaires sous toutes leurs formes et malgré toutes leurs inventions.)
« Traces » est une chance non pas simplement parce que, de la préhistoire de la psychanalyse (disons des années 1894 à 1899) jusqu’au dernier souffle de Freud, à savoir la fin de l’écriture de L’homme Moïse et la religion monothéiste – Trois essais, on en trouve partout des traces dans l’intégralité du corpus freudien, que ces traces sont précisément ce qui permet à Freud d’approcher une conception particulière de la mémoire (bien qu’il ne l’ait jamais systématisée – et voilà quelque chose qui rend la question encore plus passionnante), non pas uniquement encore parce qu’il donnera dans une lettre à Fliess un autre nom à ce nom de « traces », engrammes et que s’y entend grammé, la lettre, partant « traces » a toujours à faire avec la question de ce qui s’inscrit et donc de ce qui ne s’inscrit pas, donc de ce qui s’écrit et de ce qui s’efface, donc « traces » est toujours qu’on le sache ou l’ignore, en même temps une question d’écriture, mais « traces » est une chance, au sens de la langue, à la lettre encore, comme ce qui tombe. La psychanalyse est d’abord et avant tout occupée par celles et ceux qui tombent. Se cognent. Boitent. Il ne me semble pas inutile de le rappeler dans notre aujourd’hui politique.
Chance vient de chéance, ce qui tombe : ce qui arrive, ce qui vient. « Symptôme », en grec sumptoma, ne signifie pas autre chose que « avec ce qui arrive », survient, bref ce qui nous tombe dessus. Jeu sérieux des langues : une psychanalyse, n’est-ce pas, entre autres, ce qui transforme un symptôme en chance ? Passage de la survie à la sur-vie, à la vie plus que la vie, à la vie autre et au-delà de la vie nue, à l’intensification de la vie, etc.
Chance, chéance, ce qui arrive, ce qui relève de la venue, de la venance (des revenances) de ce qui vient, voilà ce qui invite à ne parler de la psychanalyse que comme à venir. De cet à venir irréductible à quelque futur entendu comme présent projeté tout simplement. La psychanalyse à venir, ça n’est pas la question de l’avenir de la psychanalyse, mais bien celle de ce par quoi elle est ouverte, exposée, travaillée, hantée, habitée, ce par quoi elle est obligée. Et c’est ce qui vient : tout ce qui arrive. La psychanalyse est ébranlée et structurée par tout ce qui arrive. Et c’est ce tout sans exclusive du presque rien qui raccorde encore et avec les traces et avec l’à venir qui s’y annonce toujours déjà, au-delà ou en deçà de ce qui s’y donne manifestement.
Écouter sera toujours écouter des traces.
L’affaire de l’écoute et des oreilles de la psychanalyse est corrélée à cela, en tant qu’il y va bien d’écouter ce qui ne se dit pas dans ce qui se dit. On retrouve là une distinction entre le dit et le dire que Lacan aura formulée dans un texte extrêmement difficile, L’étourdit, dont il suffit pour l’instant de faire résonner cette phrase qui met précisément en jeu l’écoute, fût-ce du presque rien – mais le « presque » fait la différence : « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend ». Dans ce qui s’entend peut fort bien rester inouï qu’on dise. Autrement dit l’écoute, celle de l’oreille inconsciente, vient prêter l’oreille et main forte à ce qui ne s’entend pas. L’écoute analytique écoute ce qui ne s’entend pas. Ce qui ne s’entend pas et qui se dit pourtant dans les dits de l’analysant.e. On pourrait appeler cela « traces » de dire dans le dit. Écouter sera toujours écouter des traces.
Deux très grands textes soutiennent ces propositions au sujet de la psychanalyse à venir et nous enseignent comment les traces ne peuvent pas ne pas nous mettre au travail. J’écris « nous », pas « nous les psychanalystes » (d’ailleurs l’un de ces textes n’est pas de la plume d’un.e analyste, ce qui n’est pas un détail), mais « nous » au sens de « ensemble », de « collectif », de « multiples », de « différent.es », de « contradictoires », de « désaccordé.es », « nous » les un.es avec les autres. Deux textes comme deux exergues, trop longs pour des exergues et surtout pas à la bonne place dans l’économie du texte. Mais la psychanalyse est aussi ce qui nous aura appris qu’il n’y a d’origine qu’un fantasme ou un délire et que le commencement n’est jamais tenu de commencer au commencement. Avec l’inconscient, comme le disait Shakespeare et le récrit Derrida dans Spectres de Marx : « Le temps est hors de ses gonds ». C’est encore ce qui arrive avec l’affaire des traces. Et justement Jacques Derrida nous montre que « traces » est l’anagramme de « écarts », et que le « hors de ses gonds » du temps à tout à voir avec son écartement, ses impossibles coïncidences entre soi et soi.
On peut maintenant lire ces deux longues citations, textes, boussoles, appuis, fondements, supports, sources :
1/ Freud d’abord, dans le Moïse :
« Il en va de la défiguration d’un texte comme d’un meurtre. La difficulté ne réside pas dans l’exécution de l’acte, mais dans l’élimination des traces. On aimerait pouvoir donner au terme “défiguration” le double sens dont il peut se réclamer, bien qu’aujourd’hui il n’en fasse plus usage. Il ne devrait pas seulement signifier : altérer dans son apparence, mais aussi : mettre à un autre endroit, déplacer et mettre ailleurs. C’est en ce sens que, dans de nombreux cas d’emploi de ce terme à propos d’un texte, nous pouvons escompter que nous retrouverons caché quelque part ce qui a été réprimé et dénié, bien que modifié et arraché à son contexte. Simplement il ne sera pas toujours facile de le reconnaître[1]. »
2/Lévinas maintenant :
« La trace n’est pas un signe comme un autre. Mais elle joue aussi le rôle du signe. Elle peut être prise pour un signe. Le détective examine comme signe tout ce qui marque sur les lieux du crime l’œuvre volontaire ou involontaire du criminel, le chasseur marche sur la trace du gibier, laquelle reflète l’activité et la marche de la bête que le chasseur veut atteindre, l’historien découvre, à partir des vestiges qu’avaient laissés leur existence, les civilisations anciennes comme horizon de notre monde. Tout se range en un ordre, en un monde, où chaque chose révèle l’autre ou se révèle en fonction d’elle.
Mais, ainsi prise pour un signe, la trace, par rapport aux autres signes, a encore d’exceptionnel ceci : elle signifie en dehors de toute intention de faire signe et en dehors de tout projet dont elle serait la visée. Quand, dans les transactions, on “règle par chèque” pour que le paiement laisse une trace, la trace s’inscrit dans l’ordre même du monde. La trace authentique, par contre, dérange l’ordre du monde. Elle vient en sur-impression. Sa signifiance originelle se dessine dans l’empreinte que laisse celui qui a voulu effacer ses traces dans le souci d’accomplir un crime parfait, par exemple. Celui qui a laissé des traces en effaçant ses traces, n’a rien voulu dire ni faire par les traces qu’il laisse. Il a dérangé l’ordre d’une façon irréparable[2]. »
Déranger l’ordre de manière irréversible. La question des traces aide à déranger – entre autres – la croyance trop sure d’elle-même en l’existence des frontières, et des frontières supposées naturelles entre les disciplines, par exemple ici entre philosophie et psychanalyse. Et encore entre histoire, philosophie et psychanalyse. Et encore entre histoire, philosophie, psychanalyse, littérature, études subalternes, de genres, queer, postcoloniales, etc. Et encore entre toutes les formes que s’inventent les pensées les plus diverses, monstrueuses, inouïes, incalculables et imprévisibles. Seule l’articulation de tout cela offrira un à venir à la pensée, à la création ou aux inventions théoriques, élargissant du même coup le corpus analytique.
Trois mots : traces, psychanalyse-à-venir (compte pour un), écoute. Cette tresse est peut-être le minimal du devenir.
Pourquoi alors ne pas justement proposer de penser « traces » comme le nom d’un commun ? Resterait à serrer de plus près ce que ce mot, ce nom, le « commun » peut, peut ne pas, ou ne peut pas parvenir à nous donner à penser, ensemble, les un.es avec les autres, mais surtout les un.es pas sans les autres. Là encore, pour engager nos passages dans les pensées, écritures, pratiques des un.es et des autres, il faudra garder en mémoire ces mots-là : « avec », « commun », « ensemble », « plus d’un.e », « pas sans »… nous avons à penser le lien qui se tisse depuis ce commun, ce que c’est qu’une communauté et communauté de quoi, s’il en faut et s’il y en a, si l’on en veut encore, si l’on en désire malgré tout, malgré l’histoire et les histoires de ce mot-là, si chargée, si impossible – et c’est encore avec « traces » que le politique est ici engagé depuis sa plus vieille et plus difficile question.
Je ne suis pas très en confiance avec ces choses-là, ces choses de frontières, ces choses de discipline non plus qui reste un mot du pouvoir de l’ordre et de la police, qu’on le veuille ou non, ces choses des oppositions binaires. Et ça n’est pas une affaire de croyance mais une affaire d’invention, d’inventions de la pensée, d’élaborations théoriques incessantes. De ceci se tissent trois mots : traces, psychanalyse-à-venir (compte pour un), écoute. Cette tresse est peut-être le minimal du devenir. Et depuis le début c’est autour d’un minimal que je tourne. Le minimal, l’imminimisable minime minimum comme dirait Samuel Beckett. Aucun hasard : la question y est du savoir, de l’insu aussi, et de quelque chose qui est peut-être une très fine manière d’approcher les traces et restes. Cap au pire, donc :
« Pénombre obscure source pas su. Savoir le minimum. Ne rien savoir non. Serait trop beau. Tout au plus le minime minimum. L’imminimisable minime minimum. »
Si je devais risquer de dire en un mot ce que j’aimerais pouvoir penser sous la locution « psychanalyse à venir », c’est qu’elle est une théorie et une pratique de l’écoute du minime, du minimal, ou encore du mineur, du presque rien, de l’infra – ordinaire et politique –, donc encore des traces, des restes, des résidus, des déchets, des rebuts.
Rencontre de Freud et de Sam Beckett, dans la préhistoire analytique. Dans une lettre à Wilhelm Fliess, Freud explique ce qu’il est en train de découvrir. Il lui donne un nom à cette découverte. En une langue mineure qui est aussi plus d’une langue. Un nom greffant le grec au yiddish. Un nom au-delà du principe de non-contradiction où le noble du savoir est attaché à la langue et aux inventions de la langue des ghettos : langues de sur-vies. La psychanalyse, cette année-là aura pour nom, pour premier nom, pour nom secret peut-être : drekkologie. Or drekk en yiddish, c’est, on pourrait trouver des euphémismes dans certaines traductions, mais drekk, c’est franchement la merde. Partant, drekkologie sera l’étude de la merde. Et si on joue avec ce que Heidegger dit du logos de phénoménologie dans le très célèbre paragraphe 7 d’Être et temps, à savoir que « logos » est un « faire voir », alors drekkologie devient un faire voir la merde. Je crois davantage que c’est un faire écouter. Et mieux encore que l’analyse nous enseigne que l’écoute qui est accueil est un faire écouter, un partage et un passage de l’écoute. Que l’écoute de l’analyste doit consister à inventer les moyens de faire écouter son écoute. Oui, on n’écoute que pour autant qu’on donne son écoute à l’écoute de l’autre.
Le 22 décembre 1897, Freud qui se compare au roi Midas, mais à un Midas inversé, écrit à Wilhelm Fliess : « C’est à peine si je peux faire le détail de tout ce qui se résout pour moi (nouveau Midas !) en… merde. Cela concorde tout à fait avec la doctrine de la puanteur interne. Et tout d’abord l’argent lui-même. Je crois que cela passe par le mot “schmutzig” [sordide] mis à la place de “geizig” [avare]. De la même manière, toutes les histoires de naissance, fausse couche, règles, en passant par le mot “Abort” (Abortus) [Abort a la double signification de “avortement” et de “cabinets, w.-c”. Abortus, mot latin mis entre parenthèses, vient expliciter le premier sens de Abort.] ramènent au lieu lui-même [Lokus (lieu d’aisances)]. »
L’à venir de la psychanalyse était ainsi engagé. Nous sommes encore sur ses traces. Nous le serons toujours. « Être à venir », c’est n’être pas. La psychanalyse, étant structuralement à venir, n’est pas. Elle devient. Il n’y a pas la psychanalyse mais un devenir psychanalyse de la psychanalyse et un devenir devenir de la psychanalyse.
