Extrême droite et inégalités sociales : leçons des législatives
Les électeurs d’extrême droite, qu’ils soient riches ou pauvres, partagent un penchant vers les valeurs traditionnelles de la masculinité, un attachement à la nation et la volonté d’exclure ceux et celles perçu-es comme « étranger-es ». Patriotisme et virilisme vont de pair, et dépassent les frontières de classe. Ce constat met à mal des analyses expéditives qui ont attribué le vote d’extrême droite à la « France rurale et populaire » et la démonstration qui mobilise la perte de confiance dans les institutions des « pauvres », des « oubliés » de la globalisation, des populations qui auraient raté la modernité, seraient restées dans la tradition.
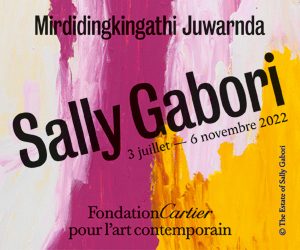
Car le virilisme existe dans les classes supérieures. Il se voit dans les statistiques sur les violences faites aux femmes. Les grandes enquêtes nationales, ENVEFF et VIRAGE, s’accordent sur le fait qu’aucun groupe social ne possède le monopole de la violence faite aux femmes. Les auteurs de ces violences, comme les femmes victimes, proviennent autant des classes supérieures que des classes les plus démunies. #MeToo en fournit d’innombrables exemples.
Mais dire que le virilisme est un phénomène qui existe dans toutes les classes sociales ne signifie pas que les classes sociales n’existent plus. Au contraire, les débats autour du vote d’extrême droite montrent les stratégies d’attribution de la responsabilité des maux de la société aux personnes les plus démunies de ressources, contribuant ainsi à renforcer les clivages de classe. L’attribution d’une « mentalité arriérée », traditionnelle, irait de pair avec un machisme qui serait spécifiquement populaire, fondé sur la force physique. Cet argumentaire sert moins à décrire la réalité des masculinités populaires, qui sont tout aussi plurielles que les masculinités aristocrates ou bourgeoises, qu’à protéger les couches privilégiées de la population de tout soupçon de domination masculine.
Attribuer une masculinité (ou une féminité) spécifique à l’Autre est un procédé connu dans le débat sur les populations musulmanes – dont les hommes seraient toujours plus machistes que les chrétiens, dans une course au « pire » qui sert à dédouaner les hommes occidentaux – en transformant y compris les plus traditionnels en défenseurs des valeurs féministes. Mais il s’agit de plus d’une arme efficace dans la construction des groupes sociaux : ainsi le genre construit la classe. Construire l’autre dans sa manière d’être un homme ou une femme, contribue à le rendre différent, à le dévaloriser, en termes d’appartenance de classe, tout en se valorisant soi-même, selon ses propres valeurs.
Attribuer aux classes populaires une masculinité homogène caractérisée par la force physique et le machisme ainsi qu’une virilité outrancière, souvent violente, éclipse la diversité des masculinités dans les classes populaires. Cette même hétérogénéité existe du côté des femmes : il existe des femmes à la féminité « virile », comme d’autres qui soignent une apparence particulièrement féminine[1].
Ainsi l’opposition entre classes urbaines éduquées modernes et politiquement progressistes et classes rurales populaires traditionnelles et machistes se révèle une fiction qui sert principalement à voiler les courants traditionnels, machistes et conservateurs des grandes villes. Mais il y a plus. L’expression d’une supériorité morale et politique chez les défenseurs de la globalisation, du progrès et de la vie urbaine a des effets excluants : le progrès ne peut pas se situer au niveau du local, dans le rural ou la lenteur.
Il faut donc penser la complexité et l’imbrication de différentes inégalités. Le vote d’extrême droite, la xénophobie, l’antisémitisme, la violence contre les femmes, les inégalités face à la globalisation sont des phénomènes complexes. Penser ensemble les phénomènes d’inégalité d’accès à des ressources économiques et sociales, à la mobilité, à l’éducation, penser aussi les discriminations envers celles et ceux qui n’ont pas la nationalité ou les sans-papiers et les personnes racisées, les discriminations contre les femmes et les personnes LGBTQI+, est un défi aussi bien pour la recherche que pour les militants et militantes politiques et tous les citoyens et citoyennes.
Gardons-nous des réponses simples, telles « c’est la faute aux riches », « c’est la faute aux classes populaires et à l’ignorance », « c’est la faute au féminisme, au woke, à l’islamo-gauchisme ou l’islamo-droitisme ». Comprendre le sens que donnent les personnes à leur existence, en raison du fonctionnement des structures économiques, politiques et sociales, est un travail méticuleux et de longue haleine, qui doit se fonder sur des enquêtes empiriques. Dans un travail récent, intitulé Comment le genre construit la classe, j’ai enquêté sur les conséquences d’une fermeture d’usine, sur les frustrations que cela entraîne et sur les mouvements politiques qui se sont formés après l’expérience concrète de la perte de l’emploi à la suite des délocalisations des moyens de production hors d’Europe.
Comment les personnes licenciées se positionnent-elles, en termes de vote, en termes de pratiques politiques au quotidien, en termes d’usage de la force physique, en termes de comportement envers les femmes et les minorités ? Comment précisément la mobilisation politique reproduit-elle des inégalités sociales existantes tout en les transformant ? Et comment les hommes qui ferment les usines (car il s’agit en très grande majorité des hommes) vivent-ils cette activité, quels modèles politiques et sociétaux mettent-ils en avant, et quelles normes de genre ?
Ce travail montre les hétérogénéités des masculinités et féminités à l’intérieur des classes populaires et des classes supérieures, tout en soulignant qu’un des ressorts de la domination masculine consiste précisément à s’appuyer sur des intérêts partagés entre hommes : que ce soit entre hommes des classes populaires, ou entre cadres et salariés. Ces intérêts partagés peuvent profiter à certains hommes, que ce soit dans leur carrière professionnelle ou dans leur leadership politique ; ils se font au détriment des femmes et ils peuvent également entraver les mobilisations politiques des salariés subalternes, en les divisant.
La violence faite aux femmes, la violence faite aux minorités, et la violence faite aux classes populaires partagent un trait commun : elles sont tout à la fois structurelles et interindividuelles.
Les sondages « sortie des urnes » et l’analyse des mouvements d’électeurs donnent des réponses partielles aux raisons du vote d’extrême droite. D’autres réponses peuvent être trouvées dans les enquêtes sur le quotidien dans les usines, les supermarchés, les bureaux, mais aussi dans l’espace domestique, la famille, le couple. Plus complexes, celles-là ; plus entremêlées de doutes ; moins univoques dans les réponses politiques à donner aux phénomènes étudiés.
Le succès de l’extrême droite en France et en Europe nous dit quelque chose sur le fait que les valeurs de xénophobie, de discrimination sexuelle et sexiste, de violence et de haine ont progressé. On ne peut pas penser l’extrême droite uniquement en termes de classes sociales démunies et frustrées. Il faut aussi comprendre le goût de certaines et certains pour la violence, la destruction, la haine des autres[2]. Le goût pour l’exclusion. La fascination d’exercer du pouvoir sur les autres. Ce goût s’exprime au quotidien, dans les relations au travail, l’humiliation infligée par le harcèlement, par exemple, qu’il soit moral ou sexuel, tout autant que dans l’intimité domestique, où une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. L’extrême droite, en jouant sur la concurrence entre groupes sociaux, encourage ce goût.
La violence faite aux femmes, la violence faite aux minorités, et la violence faite aux classes populaires partagent un trait commun : elles sont tout à la fois structurelles et interindividuelles. Et elles sont présentes au quotidien : quand on humilie un camarade au travail devant le chef, on peut en tirer du profit symbolique auprès du chef. Quand on harcèle sexuellement une femme au travail, on peut en tirer du profit auprès d’autres hommes, collègues ou supérieurs hiérarchiques. On peut passer en « chaud lapin ». Quand on couche avec la femme du chef, on peut faire rire les collègues ou faire du chantage au chef pour ne pas révéler son secret, afin qu’il ne se retrouve pas « cocu » aux yeux des autres. Quand on blague à propos d’un collègue qui ne boit pas d’alcool ou ne mange pas de porc, on peut faire rire les autres.
Ces exemples mobilisent tout à la fois les relations hiérarchiques à l’usine, le genre, et la religion. Il est très différent de harceler sexuellement une collègue ou une subordonnée de travail. Et pour comprendre ces interactions, il faut penser ensemble les différentes relations de pouvoir dans un même espace (ici du travail). C’est précisément la compréhension de ces petites banalités du quotidien[3] qui nous amène à entrevoir comment, en pratique, une société construit des inégalités de classe, de sexe, de « race » et de religion. Et ce sont précisément ces inégalités qui sont encouragées par l’idéologie d’extrême droite. Si l’extrême droite entend combattre les inégalités sociales (en augmentant le pouvoir d’achat, par exemple), elle le fait en excluant certaines populations, notamment les minorités ethniques et sexuelles en montant les populations qui manquent de pouvoir d’achat contre ces dernières.
Cette stratégie se révèle terriblement efficace. Ne la reproduisons pas en essayant d’instaurer une « priorité » de lutte contre une seule des multiples inégalités. Pratiquons plutôt une recherche et une politique qui essaient de comprendre l’imbrication de ces inégalités afin de mieux les combattre. Car ce n’est qu’en combattant l’ensemble des inégalités et des discriminations que nous arriverons à entraver le vote de l’extrême droite.
NDLR : Alexandra Oeser a récemment publié Comment le genre construit la classe aux Éditions du CNRS.
