Quand les corps se rêvent « parfaits »
Maigreur extrême, rondeurs démesurées, poitrines saillantes, lèvres débordantes, obsession du ventre et des cuisses, ces nouvelles aspirations des corps féminins se répandent comme des épidémies incontrôlables. Sous prétexte de liberté, elles dissimulent mal les contraintes qu’elles imposent au prétexte de correspondre au seul idéal d’un corps « parfait » formaté par des millions d’images instantanées. Un récent article du Monde[1] soulignait l’augmentation importante de la chirurgie esthétique chez les 18-35 ans du fait de l’influence des images d’Instagram.
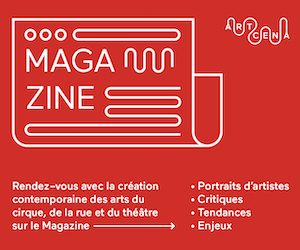
D’où viennent ces images ? Pourquoi un tel pouvoir sur les corps ? En reprenant l’histoire des images du féminin, il me semble aujourd’hui possible de trouver l’intelligibilité de ces comportements qui peuvent aller jusqu’à des formes nouvelles de pathologies psychologiques et psychiatriques, que j’appelle les pathologies de l’image. Elles sont la conséquence de ces mouvements de société et peuvent s’associer aux troubles des conduites alimentaires – anorexie et boulimie déjà connues – et qui sont en nette augmentation ces dernières années.
La réflexion sur le corps et le paraître est donc primordiale et inséparable d’une réflexion plus approfondie sur les évolutions de nos conceptions de la beauté. En s’appuyant sur les travaux de l’historien Georges Vigarello, on peut se demander comment l’on passe d’une perception de la beauté qui serait « don de Dieu », héritée du Moyen-Âge, à ce qui se produit aujourd’hui, à savoir, une obligation, voire un impératif, où le corps semble stéréotypé selon des canons bien précis : le corps doit être mince, voire maigre, musclé, lisse et hâlé et désormais chirurgicalement modifié. Cette transformation des corps s’accompagne d’une très florissante industrie : les cosmétiques bien sûr, c’est-à-dire les produits dits « de beauté », jusqu’au développement sans précédent de la chirurgie esthétique.
La plupart des troubles alimentaires, comme l’anorexie et la boulimie, son
