En passant par l’Espagne : notre contemporain Georges Bataille
En 1922, il y a exactement cent ans, de février à juin, Georges Bataille séjourne à Madrid, à l’École des hautes études hispaniques, qui deviendra ensuite la Casa de Velázquez[1]. Il a alors 25 ans et vient de sortir second de l’École des Chartes – la tradition veut que le premier aille à Rome et le second à Madrid. Après quelques semaines difficiles, qu’il passe, comme il l’écrit à sa sœur Marie-Louise, « dans un état mixte », « parfaitement désagréable », qui « ne comporte ni enthousiasme ni désolation », il « commence à pressentir une Espagne pleine de violence et de somptuosité, ce qui est un fort agréable pressentiment »[2].
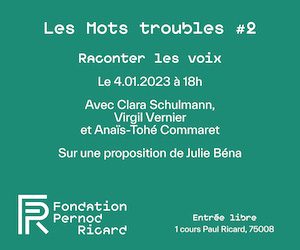
Cette Espagne pressentie, il va la découvrir dans les formes vives de son folklore : un concours de cante jondo auquel il assiste à Grenade, un spectacle de flamenco qu’il va voir plusieurs soirs de suite à Madrid et les corridas auxquelles il se rend régulièrement. La « violence somptueuse » atteint son comble à l’occasion de l’une d’entre elles : le 7 mai, dans les arènes de Madrid, il assiste en direct à la mort et la mutilation spectaculaire du torero Manuel Granero.
Une vingtaine d’années après, Bataille reviendra sur cette expérience espagnole, dans un article de 1946 consacré à Pour qui sonne le glas d’Ernest Hemingway[3]. Entre temps, quelques autres séjours et de nombreuses occurrences textuelles seront venues rappeler la place insistante de l’Espagne chez un auteur qui aurait pu faire sienne la formule finale du Journal du voleur de Jean Genet : « cette contrée de moi que j’ai nommée l’Espagne ». Des arènes de Séville, dans lesquelles Bataille transpose la mort de Granero dans Histoire de l’œil, au Barrio Chino de Barcelone, dont il fait dans Le Bleu du ciel un point névralgique, condensant les troubles politiques de la guerre civile et le milieu interlope des cabarets, en passant par la tragédie Numance de Cervantes, à laquelle il assiste en 1937, les Exercices spirituels de Saint Jean de la Croix ou les peintures de Go
