Faut-il aller à la télé ? Le sociologue et les sollicitations médiatiques
«La télévision, à travers différents mécanismes que je m’efforce de décrire de manière rapide – une analyse approfondie et systématique aurait demandé beaucoup plus de temps –, fait courir un danger très grand aux différentes sphères de la production culturelle, art, littérature, science, philosophie, droit ; je crois même que, contrairement à ce que pensent et à ce que disent, sans doute en toute bonne foi, les journalistes les plus conscients de leurs responsabilités, elle fait courir un danger non moins grand à la vie politique et à la démocratie[1] ».
Sans nommer explicitement Pierre Bourdieu, on peut imaginer que c’est à lui que répond Robert Castel lorsqu’il affirme, quatre ans après la parution de Sur la télévision : « Une attitude très commune dans le milieu sociologique consiste à dénoncer les simplifications outrancières et les interprétations partiales, si ce n’est perverses, que le traitement médiatique fait subir au travail sociologique. Cependant, les mêmes se plaignent souvent de la confidentialité à laquelle leurs recherches sont condamnées[2] ».
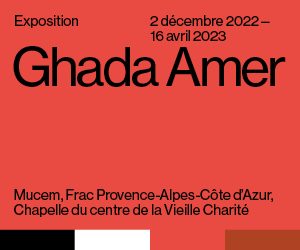
Cette question n’est ni nouvelle ni originale, mais elle est cardinale, car en allant sur un plateau télévisé (ou en refusant d’y aller), chaque sociologue engage sa responsabilité professionnelle et celle de la communauté scientifique qu’incidemment il représente. Certains collègues sont invités et acceptent, d’autres sont invités et refusent, d’autres encore ne sont jamais invités et s’en contentent parfaitement, enfin, certains ne sont pas sollicités mais aimeraient l’être. Les deux dernières catégories sont tout aussi concernées par la question – faut-il y aller ? – que les deux premières car l’accès à l’arène télévisuelle ne repose pas uniquement sur des capitaux (tel ancien camarade de Sciences Po travaille chez France télévisions) et sur des hasards (telle guerre dans tel pays auquel vous avez consacré votre thèse vous propulse soudainement sous le feu des projecteurs) mais aussi sur des str
