Pour une éco-mise en scène
Au début de cet été 2023 sont sortis dans les salles deux films clairement engagés en faveur de la cause environnementale, Les Algues vertes de Pierre Jolivet et Sabotage de Daniel Goldhaber.
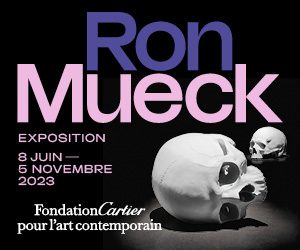
Deux fictions, l’une française l’autre étatsunienne, qui mobilisent des ressources du spectacle cinématographique pour plaider la cause de l’action contre la destruction des conditions d’habitabilité de la planète.
Le premier est inspiré de l’expérience vécue de la journaliste Inès Léraud ayant mené une enquête difficile en Bretagne pour rendre publique l’invasion ravageuse des plages et littoraux du fait de l’usage intensif d’engrais chimiques. Elle avait ensuite raconté cette affaire dans une bande dessinée, Algues vertes, l’histoire interdite, dont le film est l’adaptation vigoureusement incarnée, notamment par Céline Salette dans le rôle de la journaliste.
Le second film est inspiré, de manière beaucoup plus indirecte, par l’essai d’Andreas Malm Comment saboter un pipeline. Il mobilise les codes du thriller, plus précisément du film de braquage, pour conter le passage à l’acte d’un groupe hétéroclite de jeunes Américains, tous d’une façon ou d’une autre victimes des dérèglements environnementaux engendrés par les pratiques sauvages du capitalisme, en vue de faire, donc, sauter un pipeline dans un coin désertique du Texas.
Ces deux exemples récents, et dont la réalisation répond avec efficacité aux objectifs de dénonciation dont ils sont clairement porteurs, confirment combien le cinéma travaille à prendre en charge de son mieux les enjeux environnementaux. Couvrant un très vaste éventail quant aux types de films, le sujet est clairement devenu un enjeu largement pris en charge par les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs… Qu’ils relèvent de ce qu’on qualifie de fiction ou de documentaire, les exemples sont multiples, en dehors des utilisations purement informatives et militantes, avec des titres comme Une vérité qui dérange ou Demain en modèles les plus
