Dé-penser les territoires entre terre et mer
Les littoraux font l’objet de menaces de plus en plus visibles dont les acteurs subissent les conséquences (submersion, recul du trait de côte, salinisation des nappes aquifères).
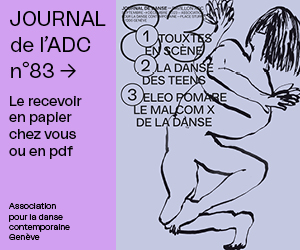
Les réponses le plus souvent apportées témoignent d’une non prise en considération de la spécificité des milieux vivants et de leur imbrication avec les humains et leurs activités. Le plus souvent, nous réagissons à ces milieux comme s’ils étaient inertes, un décor ou un support passif de nos actions.
La notion de territoire dans ses usages les plus fréquents annule les propriétés vivantes des sols et des milieux terrestres et marins ainsi que les transactions dont ils sont les sujets avec les humains. L’hétérogénéité des ajustements de ces franges maritimes face aux changements globaux nécessite de réinscrire le territoire dans sa matrice organique et environnementale afin de saisir les qualités qui conditionnent sa durabilité ainsi que les relations dynamiques dont il est l’objet.
Les littoraux sont, par essence, topographiques, des lieux de mosaïques entre terre et mer. Des liens multiples s’y tissent entre le liquide et le solide, entre l’inerte et le vivant, entre l’immobilité et le flux, entre le visible et l’invisible. Certains font face aux changements avec une certaine plasticité et porosité ; ils ont une large marge d’adaptation, de négociation et de recomposition alors que les aléas climatiques et biologiques les transforment sans cesse. D’autres ont moins de plasticité et ils basculent dans des crises passées et à venir, plus violentes, où leur forme et leurs dynamiques sont profondément remises en question par les tempêtes, les sécheresses, les invasions d’espèces, les pollutions, les constructions, etc.
Pour prendre la mesure des changements en cours tant cognitifs que pragmatiques, nous avons pris le parti pris d’imaginer et d’esquisser des idéaux types de territoires tenant compte de leurs caractères et propriétés dynamiques. La construction d’idéaux types de terr
