Ouvrir l’éventail, ou de la lisibilité
Cher Guillaume Blanc-Marianne,
Votre enquête minutieuse et contextualisée sur la photographie de Gilles Caron – image de laquelle « tout est parti », dites-vous justement, dans ce débat sur la politique des images – nous est infiniment précieuse. C’est l’intervention nécessaire que ce débat attendait. Lorsque celui-ci a débuté, en mai 2022, je me disais bien que la première chose à faire, de ma part ou de celle d’Enzo Traverso, eût été de remonter aux sources, c’est-à-dire de travailler dans l’archive photographique de Gilles Caron et de vérifier ce qui se passait, d’une image à l’autre, sur ses planches-contact. C’est l’argument que j’opposai d’ailleurs, prêt à m’atteler à cette tâche, aux demandes un peu précipitées de publications en ouvrage de ce débat : tant qu’on n’en savait pas plus sur la « teneur chosale » – en attendant la « teneur de vérité », pour autant qu’elle soit accessible – de cette photographie, les arguments en jeu, ou en lice, risquaient fort, assurément, de tourner en rond.
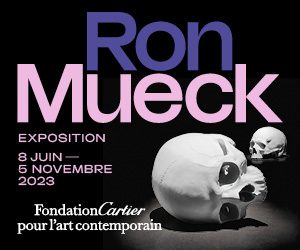
Comme en diagonale de nos échanges de lettres, vous avez pris la décision, le temps et l’énergie d’effectuer ce travail jusqu’à des résultats désormais indubitables. Et je vous en remercie vivement, heureux que ce soit quelqu’un d’extérieur au débat lui-même – mais, à présent, vous en faites partie, et au titre d’intervenant majeur –, spécialiste de Caron et de la photographie de presse, à obtenir et formuler de tels résultats. Il est établi désormais, grâce à vous, que les deux « lanceurs de pierre » photographiés par Gilles Caron à Derry le 13 août 1969 ne sont pas des unionistes protestants mais bien des militants catholiques et que, comme j’en avais aussi fait l’hypothèse – une hypothèse seulement, présentée comme telle mais fondée sur l’information selon laquelle des cordons de policiers protégeaient, ce jour-là, les cortèges unionistes –, le groupe de personnes visibles à l’arrière-plan de l’image étaient des forces de l’ordre et non des pompiers comme Enzo T
