Ce que peut l’école
Vendredi 13 octobre, alors que dans la matinée un enseignant avait été assassiné dans un lycée d’Arras, je suis allé chercher mon fils à l’école. J’ai franchi comme d’habitude la grille d’entrée, toujours ouverte, dit bonjour à la dame qui faisait, comme d’habitude, l’accueil, puis, quelques pas plus loin, alors que je descendais vers les salles de cours, j’ai vu deux policiers, l’un des deux était armé d’un fusil tourné vers le sol, se tenant droits face à la cour de récréation, à l’entrée du bâtiment principal. J’ai poursuivi mon chemin, tête basse, pour aller, comme tous les jours, retrouver mon fils devant sa salle de cours. Au bout de cinq pas, j’ai cependant arrêté ma marche.
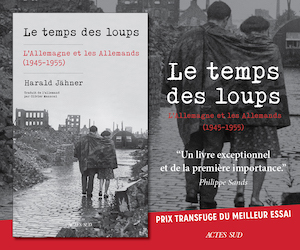
Non. Il n’était pas possible que je passe à côté de cette image ; l’image de deux hommes armés au milieu d’une cour d’école. Je ne pouvais pas passer à côté sans m’y arrêter, sans la regarder en face ; la regarder vraiment. J’ai fait demi-tour sans trop savoir ce que j’allais faire, ce que j’allais dire à ces deux hommes qui ne faisaient que leur travail. J’ai fini par m’adresser à eux, d’un ton plutôt empathique qui sonnait parfaitement faux, pour leur demander si c’était nécessaire. Fallait-il vraiment qu’ils se tiennent là, à l’intérieur d’une école ? « Il faut qu’on se tienne au plus près d’une intervention éventuelle, Monsieur. Pour vous protéger ». Puis, devant ma perplexité et sans doute aussi cette émotion que je dissimulais à peine, l’indéfectible renvoi vers le ministre ; « c’est lui qui décide, Monsieur », et ma reconnaissance, mon sentiment profond d’incompréhension mêlé à la soumission volontaire à ceux qui nous protègent, « oui, je sais Messieurs, vous ne faites que votre travail et je vous en remercie ».
Seulement voilà que sans blâmer personne ni exiger de quiconque cette forme de rébellion, ou de résistance, dont on veut toujours croire que l’on serait capable de faire preuve soi-même à la place des autres ; sans même questionner mon propre rapport à l’ordre et
