Le 7 octobre et sa part mémorielle
Parmi les réactions publiques déclenchées par les attentats du 7 octobre, il est très fréquemment fait référence à des périodes ou à des événements historiques pourvus d’un sens mémoriel fort.
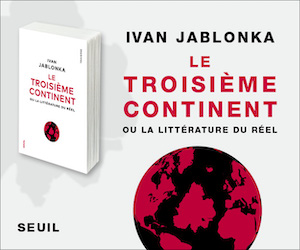
D’un côté, la volonté exterminatrice dont des civils israéliens ont été la cible à l’intérieur de leur frontière nationale est associée à un pogrom ou au génocide des Juifs perpétré par les nazis, d’autant que la volonté des groupes islamistes en question est de faire disparaître Israël. De l’autre, la puissance des moyens utilisés pour neutraliser les factions armées implantées dans un territoire peuplé de plus de 2 000 000 d’habitants se trouvant, de facto, au cœur des affrontements, est dénoncée par quantité de prises de parole véhiculant également leur lot de renvois au passé. « Génocide », retourné cette fois contre Israël, « nazi », « fasciste », « colonisation », « apartheid » comptent parmi les termes les plus souvent avancés.
Or, tout se passe comme si la violence sidérante des événements empêchait la plupart du temps de s’interroger sur les énoncés en tant que tels qui alimentent cette véritable scène publique où il est débattu, au jour le jour, du 7 octobre et de ses suites, et dans laquelle l’histoire et la mémoire tiennent une place centrale, à la fois référentielle et argumentative. On va dire ce sont ou ce ne sont pas des « nazis » ; c’est ou ce n’est pas un « génocide » ; « voilà un régime d’apartheid », sans recourir à cette autoréflexivité minimale qui permet de se distancier de ce dont on parle – ou de discerner ce qui vient parler à travers soi. Voilà l’intention que ce texte essaie de développer sans prétendre, eu égard au foisonnement des dits et des dires, livrer une analyse accomplie ; voilà l’ouverture qu’il propose pour visiter cette scène discursive.
Commencer d’évaluer la part que ces références appartenant à une culture mémorielle commune ont dans notre relation à ces événements sans précédent s’impose. De quel contexte ces mots sortent-i
