Israël-Gaza : contre le campisme
Le bilan de la guerre menée à Gaza se chiffre désormais en dizaines de milliers de victimes palestiniennes. Alors que l’inquiétude politique se noue de plus en plus autour de la question du devenir de Gaza ou de l’impasse de la guerre, d’autres dommages, certes symboliques, apparaissent. Face à un sensationnalisme médiatique, à des analyses de surface qui inondent les supports d’information, la science sociale peine à se faire entendre à dégager un espace qui lui est propre, quand elle n’est pas caricaturée.
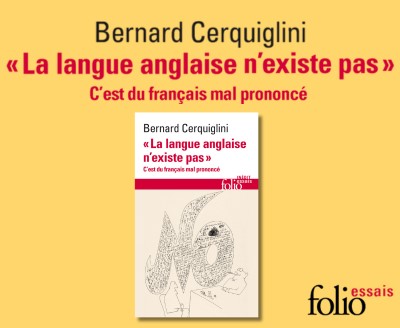
L’une des raisons en est que l’enjeu ne réside pas dans la problématisation du conflit, mais dans une lecture simpliste des sociétés israélo-palestiniennes. Le traitement du conflit relevant de plus en plus d’un processus de mise en actualité[1], ce sont les interprétations à distance et souvent pauvres en contenus qui sont privilégiées, au détriment des descriptions et de la problématisation. Ce constat concerne particulièrement les positions militantes qui reflètent les voies par lesquelles la politique existe dans l’espace public.
Il n’existerait que deux camps qui divisent le monde : les anti-Israéliens (ou antisionistes propalestiniens) et les antipalestiniens (ou pro-israéliens). Cette exploitation binaire de la guerre relève du campisme, mais on peut élargir cette notion en prenant en compte le fait que ces analyses sont effectuées à distance. Ce type d’empathie, parce qu’elle est lointaine et la plupart du temps sans connaissance réelle des réalités, accroît la critique et donne lieu à une montée hâtive en généralité des militants et de l’opinion publique. Nul doute que celle-ci se trouve actuellement renforcée par les exactions israéliennes à Gaza.
Pour relever ce type de geste idéologique, il faut se pencher sur la récurrence de certaines notions dont regorgent les tribunes dans les médias. Nous considérerons ici seulement les positions militantes en soutien à la Palestine, venant en appui du Sud global, de l’anti-racisme ou de l’anti-impéria
