Macron, prince empêché
«C’est le secret le mieux gardé de la République, écrivait François Mitterrand en 1964 dans Le Coup d’État permanent, il n’y a plus de gouvernement. Il y a en France des ministres. On murmure même qu’il y a encore un premier ministre. Mais il n’y a plus de gouvernement. Seul le président de la République ordonne et décide. »
Ces mots révèlent en ce long été de l’« abstinence » politique une étrange prescience de ce que contenait en puissance la Ve République. Car Mitterrand ne visait pas dans cette critique une situation politique particulière, présente ou à venir, mais l’essence même de la constitution gaulliste. Depuis le 7 juillet, l’essence est devenue expérience, la potentialité s’est actualisée. Impossible de l’ignorer. Il n’y a plus de gouvernement, les ministres expédient les affaires courantes. Seul le président de la République ordonne et décide.
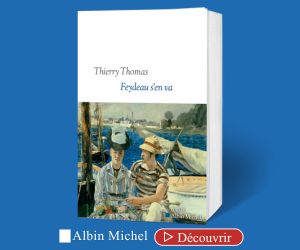
Il décide quoi ? Il décide de ne rien décider. Il vaticine, tergiverse, laisse planer le doute. Il ne nomme pas de premier ministre ce que la Constitution l’enjoint de faire (article 8), notamment après des élections législatives gagnées ou perdues. Il s’enferme dans sa fonction, délibère avec lui-même. Il proclame la « parenthèse olympique », une sorte de suspension de la vie politique, réplique du confinement à l’usage de la vie démocratique. Il inaugure les Jeux sinon les chrysanthèmes.
Les jeux achevés, il ouvre aussitôt une séquence de consultation des partis avec pour seul objectif, non pas de choisir un premier ministre mais d’en écarter le principal parti d’opposition et sa candidate. L’opération est transparente, si transparente que les médias lui ont emboîté le pas sans rechigner.
Emmanuel Macron fait tout à l’envers. C’est la partition du macronisme. Il ne nomme pas. Il écarte. Il ne compose pas, il dissout. Macron n’exerce pas le pouvoir, il l’interprète. Depuis deux ans, il donne de la fonction présidentielle une interprétation paradoxale, composant par petites touches l’autoportrait d’un pr
