Donald Trump ou la théorie du bouffon
La troisième campagne présidentielle de Donald Trump parachève par ses excès et ses outrances un parcours politique qui a dévasté tel un cyclone la scène politique américaine et mondiale. Et, face à ce cyclone, l’opinion publique éclairée est sans voix, partagée entre le scepticisme et la sidération, écrasée par un sentiment d’incompréhension qui n’a cessé de s’amplifier depuis le traumatisme de la victoire de Trump en 2016.
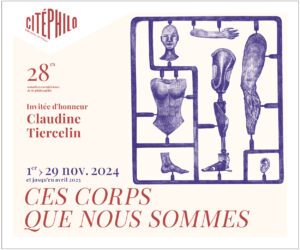
Depuis cette date, la vie politique se donne à lire comme une succession de chocs, un parcours erratique que Barack Obama avait résumé au soir de la victoire de Donald Trump, en 2016, par ces mots : « L’histoire ne va pas en ligne droite, elle fait des zigzags. » La victoire de Donald Trump en 2016 ne constituait pas seulement une défaite électorale pour les démocrates, elle prenait en défaut tous les systèmes de prévision et d’alerte, elle ruinait la crédibilité des analystes et des commentateurs, et par conséquent échappait à toute logique à leurs yeux. C’était une anomalie politique, un événement extravagant qui n’entrait pas dans le scénario de la victoire annoncée de Hillary Clinton.
« L’une des choses les plus déconcertantes était que personne, quel que soit son degré d’érudition, n’avait une idée de ce qui se passait », se souvenait Michelle Goldberg dans un article du New York Times, « Anniversaire de l’Apocalypse », publié un an après l’élection de Trump. Dans son désarroi, elle s’était alors tournée vers des journalistes qui vivaient ou avaient vécu sous un régime autoritaire « pour tenter de comprendre comment la texture de la vie change lorsqu’un démagogue autocrate prend le pouvoir ».
Un journaliste turc laïc lui avait dit d’une voix triste et fatiguée que les gens pouvaient défiler dans les rues pour s’opposer à Trump, mais que les protestations finiraient probablement par s’éteindre et que « le sentiment d’une stupeur d’urgence céderait la place à une opposition soutenue ». L’écrivaine dissidente russe Masha Gessen avert
