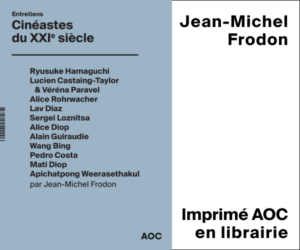Michel Foucault, critique radical de l’URSS
L’URSS a joué, dans le travail de Michel Foucault, une place stratégique, sans proportion avec les textes qui lui sont consacrés[1]. Il s’est démarqué de certaines positions qui, à partir de son analyse de la démocratie et de sa théorisation de l’enfermement, voudraient faire de l’URSS une société qui relèverait du même type que les régimes politiques occidentaux : le goulag n’est pas la prison en Angleterre ou en France[2].
Dans le cours « “Il faut défendre la société” » (1976), Foucault a théorisé la proximité conceptuelle entre nazisme et stalinisme à partir de sa réflexion sur « la guerre des deux races ». Le modèle de la « surveillance » et de la « guerre des classes/races », mêlant théorie de la lutte des classes et de l’hygiène sociale, a été mis en œuvre dès les premières années du régime soviétique, né du coup d’État que les bolcheviks ont organisé en octobre 1917, à Saint-Pétersbourg. Cette dictature du Parti-État par Lénine, Trotski et Staline a implanté des dispositifs coercitifs, dont les camps de concentration[3].
Dressons, par exemple, un portrait rapide de Maria Spiridonova, qui a accédé à la notoriété au lendemain de la révolution de 1905. À vingt-deux ans, elle révolvérise un notable champion de la répression du régime tsariste. Sa sentence est la peine de mort. Mais, après une campagne d’opinion, elle séjourne dans un bagne jusqu’à la révolution de février 1917, où elle recouvre la liberté. Elle appartient au Parti socialiste-révolutionnaire de gauche et, à ce titre, elle participe au Congrès des Soviets en juillet 1918 ; à ce même congrès, Lénine utilise le terme « hystérie » à son égard.
Elle est constamment et résolument dans l’opposition aux bolcheviks : en février 1919, le tribunal révolutionnaire de Moscou la condamne à l’incarcération dans un « centre de cure » en avançant qu’elle est dans un soi-disant état maladif et « hystérique »[4]. Par la suite, Maria Spiridonova est ballotée dans les diverses institutions répressives de l’URSS. Elle