Cinq ans plus tard : retour sur le monde d’avant et le monde d’après
Il y a cinq ans, le 16 mars 2020 au soir, Emmanuel Macron annonçait aux Français qu’ils étaient confinés[1], pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 qui avait submergé le système sanitaire, en France et dans le reste du monde.
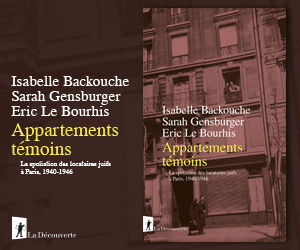
Nous nous sommes trouvés dès le lendemain dans un autre monde où, privés de notre liberté d’aller et de venir, nous avons redécouvert quels étaient les métiers essentiels, indispensables à nos existences : métiers de la santé, éboueurs, pompiers, pompes funèbres, chauffeurs-livreurs, paysans, boulangers, tous ceux qui ont permis la poursuite de l’approvisionnement en produits alimentaires des villes et des campagnes, scientifiques travaillant sur la mise au point d’un vaccin. En bref, pour l’immense majorité d’entre eux, les emplois les plus mal rémunérés en France comme ailleurs.
Dans le même temps, l’absence au bureau des directeurs, des cadres, des managers en tout genre, des contrôleurs de gestion, des consultants, des financiers, de tous ceux qui occupent les emplois les mieux payés, ne posait, elle, guère de problèmes. Ils se rassemblaient le soir, sur leur balcon, pour applaudir ceux qui continuaient à travailler et permettaient aux pays de vivre dans les nouvelles conditions créées par le confinement.
Nous nous sommes aperçus, en même temps, qu’un pays comme la France ne disposait plus des capacités lui permettant de fournir des masques de protection aux médecins et à la population, pas plus que du gel hydroalcoolique, des vaccins et plus globalement de la plupart des produits industriels dont nous faisons un usage quotidien. Le mot de souveraineté a connu une nouvelle fortune, au moins dans les discours.
Ce choc nous a conduits, également, à nous demander si ce que nous appelons notre développement économique n’avait pas une responsabilité dans l’apparition et la diffusion extrêmement rapide de cette pandémie et si ce à quoi nous consacrons nos énergies avait véritablement un sens.
L’espoir que le monde d’aprè
