Laïcité : le grand malentendu
Comment, de principe organisant la coexistence des libertés, la laïcité est-elle devenue une valeur, laquelle serait étrangère à ceux dont la religion ou la culture ne permettraient pas d’en comprendre l’exigence ? Tout indique qu’il convient de s’inquiéter d’une puissante montée de l’intolérance par rapport à l’expression de la différence.
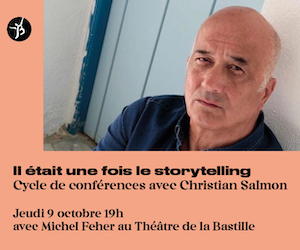
Quels que soient les oripeaux dont elle se pare, notamment la nécessité de renforcer la cohésion nationale, l’intolérance des « entrepreneurs de morale[1] » est un puissant marqueur de l’évolution de l’opinion.
Cette évolution est congruente avec le fait qu’un parti d’extrême droite, qui se pose en héraut de la laïcité, et dont le programme repose sur le refus de la différence, occupe désormais une place majeure dans notre vie politique. Pour le Rassemblement national, l’étranger est supposé dénaturer nos paysages familiers, transformer nos mœurs, bref remettre en cause notre homogénéité fantasmée. Sa revendication première est de priver de droits ceux qui, par leur origine ou leur confession, sont censés menacer l’intégrité de la nation. Les bienfaits de l’État-providence ne doivent être destinés qu’au « vrai peuple », le populisme[2] procédant d’une révolte contre le partage des acquis sociaux durement obtenus sur le long terme avec de nouveaux venus, lesquels, en raison de différences non rattrapables liées à l’origine, ne les mériteraient pas.
Les affrontements sur la laïcité ne sont évidemment pas les seuls indices du rapport pathologique à l’altérité. Cependant, à de nombreux égards, ils traduisent adéquatement ce qui se joue sur d’autres terrains, notamment sur celui de la liberté d’expression, où s’affrontent, d’une part, anti-wokistes, affirmant leur désir de protéger les mœurs démocratiques contre les tentatives d’annuler les œuvres, et, d’autre part, défenseurs de la justice sociale et raciale, lesquels, non parfois sans excès (relevant du sectarisme militant), se veulent attentifs aux divers types de discrim
