Entre visibilité et invisibilité (transparence et désubjectivation 1/2)
La transparence est depuis quelques années l’objet de nombreux débats : est-elle une bonne ou une mauvaise chose, faut-il être pour ou contre ? Ses amis et ses ennemis s’affrontent dans de nombreuses revues et conférences. La discussion, qui porte en priorité sur des thèmes comme la gouvernance, mais aussi, à un niveau plus individuel, sur la surveillance, sur le retour numérisé de Big Brother, et donc sur les frontières aujourd’hui brouillées entre les sphères publique et privée, n’est pas près de trouver sa conclusion. En tout cas les ambiguïtés du terme comme son élasticité n’y contribuent pas. On s’avise sans doute trop peu que la transparence est un terme dont le champ sémantique est non seulement très large, mais qu’il recèle également son pesant de pièges et de contradictions dès lors qu’on le serre de plus près, dès lors qu’on en prend le potentiel sémantique au sérieux.
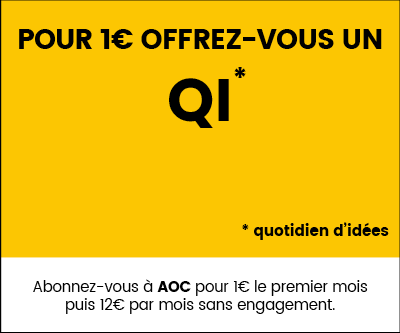
A un premier niveau, qui implique avant tout des problèmes de gouvernance, il semble difficile de ne pas souscrire à la transparence, ou à plus de transparence, puisque celle-ci est alors perçue plus ou moins comme un synonyme d’honnêteté ou éventuellement de responsabilité, soit des vertus qui ne sont pas exactement nouvelles. On convient que ce serait une bonne chose pour la démocratie que les représentants de l’État déclarent leurs revenus et leur fortune, même si de toute évidence c’est loin d’être acquis partout. Plus généralement on s’entend pour estimer qu’il est préférable que les personnes publiques (les représentants de l’État mais aussi les responsables d’entreprises, etc.) ne se vautrent pas (trop) dans le secret, la corruption et le mensonge et qu’il soit possible de leur demander des comptes.
Nous nous rendons également compte que le contraire de l’exigence de transparence, ce ne sont pas nécessairement ou seulement le secret et la corruption, mais également, par exemple, la confiance.
Donc pas d’affolement, se dit-on, rien ne serait en somme plus normal que l’exigence de tr
