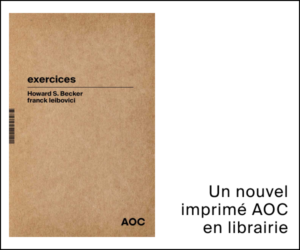Performance : la fièvre des archives
Alors que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel fait aujourd’hui partie des préoccupations majeures dans le secteur culturel, elle peut à première vue sembler étrangère au champ des arts visuels et plastiques. Pourtant, depuis la seconde moitié du vingtième siècle, une pratique d’avant-garde pose des défis similaires : la performance.
Émergeant aux côtés de pratiques comme la peinture ou la vidéo qui sont définies par leur matérialité, la performance est au contraire une forme artistique corporelle, vivante et éphémère. Les artistes la définissent souvent comme un événement unique, qui ne se reproduit pas ; elle ne laisse pas de traces, ou bien celles-ci ne comptent pas.
Au premier abord, ce genre artistique semble donc réfractaire voire antinomique aux enjeux relatifs à la conservation, à la mémoire et à la transmission. Et pourtant il est essentiel aujourd’hui de s’interroger à propos de ses traces et plus précisément de ses archives, justement parce que celles-ci présentent cette fragilité. Du fait même de la tension qui les caractérise, les sources de la performance peuvent aujourd’hui nous aider à façonner les catégories avec lesquelles nous pensons les œuvres, l’art, et leurs histoires. L’inauguration de la plateforme Performance Sources est aujourd’hui l’occasion de déployer ces questions.
« La réalité elle-même » : c’est ainsi que l’artiste Gina Pane définit la performance au début des années 1970, tandis que cette pratique nouvelle se développe dans les mondes de l’art contemporain. La performance fait alors partie des courants d’avant-garde expérimentaux qui sont apparus progressivement et surtout à partir des années 1950, aux côtés de l’art vidéo, du land art, de Fluxus, du minimalisme, ou encore de la danse postmoderne ; elle se diffuse au Japon, en Europe de l’Est et centrale, dans les Amériques. Le terme de « performance » vient de l’anglais, performing arts désignant les arts vivants, et performance, une représentation théâtrale ; pendant l