Il faut historiciser l’actualité ! Face à la complexité du monde 2/2
Les premiers cas que j’ai exposé – les dernières élections au Zimbabwe et au Mali – suggèrent déjà que l’anatomie de la domination, et notamment l’économie politique de la coercition[1], dans des situations historiques concrètes, sont plus instructives que les platitudes sur la gouvernance ou la démocratie. C’est ce que confirment deux autres événements de l’été : l’élection présidentielle au Cambodge, le 29 juillet, et l’exacerbation de la contestation (et de sa répression) au Nicaragua.
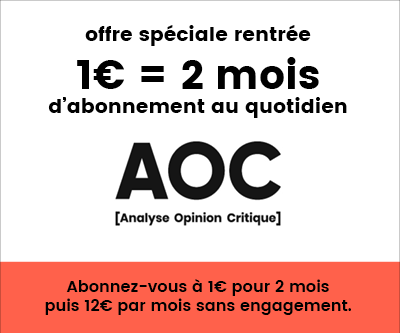
Dans les deux cas, nous sommes en présence d’une situation thermidorienne[2]. Une élite politique, installée au pouvoir par la grâce d’une mobilisation révolutionnaire d’orientation socialiste, celle-ci fût-elle militaire ou insurrectionnelle – respectivement celle des communistes cambodgiens initialement formés par le Parti communiste vietnamien, devenus Khmers rouges, avant, pour certains d’entre eux, dont Hun Sen, de revenir dans le giron de Hanoï ; et celle des sandinistes – se convertit au néolibéralisme pour se maintenir au pouvoir, et fait alliance avec le capitalisme étranger tout en gardant le contrôle de l’appareil coercitif d’État.
Une telle situation thermidorienne se retrouve dans la Russie postsoviétique, en Chine, au Vietnam, mais aussi en Iran, et elle se dessine à Cuba. Derechef, le contrôle de l’État garantit celui de l’économie, toujours selon cette même logique du chevauchement entre différentes positions d’influence et d’autorité. Et le partenariat public-privé, cher aux néolibéraux, fait merveille, éventuellement sous les atours de l’institution islamique du waqf [3]. Encore faut-il souligner qu’il s’agit moins d’un retrait de l’État[4] que de sa reconfiguration, sous la forme de sa privatisation[5]. Cette dernière est évidemment indissociable, aujourd’hui, du capitalisme avancé, et notamment financier, même si sa composante foncière demeure beaucoup plus déterminante qu’on ne le dit habituellement. Cependant elle renoue avec la formation de l’État du Premier
