Le monde selon GPT ? (1/2) Trois conditions philosophiques et l’espace des intelligences
Rien au fond de très nouveau ici. Même si – selon le mot fameux de Whitehead – la philosophie apparaît avec raison comme une note en bas de page de Platon, les grands événements dans la science et la technique ont régulièrement rebattu les cartes de la métaphysique et de l’épistémologie – qu’on pense à la révolution darwinienne, ou, au début du XXe siècle, aux événements de la théorie mathématique des ensembles, de la physique quantique et de la théorie de la relativité, ou même, plus loin dans le temps, à la science newtonienne dont est tributaire toute la philosophie ultérieure.
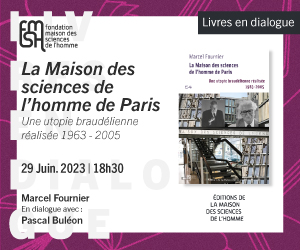
Aujourd’hui, l’Intelligence artificielle joue ce rôle, essentiellement sous le mode des intelligences artificielles génératives. Celles-ci ont émergé au grand jour avec ChatGPT, membre de la famille des Large language models (ou LLM), et les générateurs d’images Midjourney ou Dall.E, mais les avancées qui les constituent s’accumulèrent pendant quatre ou cinq ans à l’ombre des laboratoires et des instituts de recherche[1]. Épatantes pour le commun des mortels, elles le sont tout autant ou davantage pour le philosophe. Davantage, parce qu’elles relancent de vieilles interrogations sur l’essence du savoir ou de la pensée, sur la spécificité humaine ou sur le langage.
Loin de faire le point sur ce qui s’est dit et discuté depuis quelques mois par les divers philosophes[2], je vais suggérer deux ou trois pistes pour comprendre en quoi GPT fournit l’occasion de penser à nouveau. Mon fil directeur est très simple : dans quel monde vit un LLM ? Que nous en dit-il ?
La base philosophique de GPT
Le compagnonnage de l’Intelligence artificielle et de la philosophie n’a pas attendu les Large langage models. Au contraire, les discussions philosophiques étaient parties prenantes de la naissance de l’IA, puisque ce projet même relève d’un intérêt philosophique pour la compréhension de l’esprit humain. Forgé lors de la Conférence de Dartmouth de 1956 (qui regroupait entre autres Herbert Simon, Cl
