Le lycée professionnel en réforme : régression et mépris
La réforme du lycée professionnel et sa mesure phare, le rallongement des périodes de stage, n’est pas un projet original puisqu’elle s’inscrit dans la droite ligne d’un choix politique opéré dans les années 1980, celui de rapprocher l’école de l’entreprise.
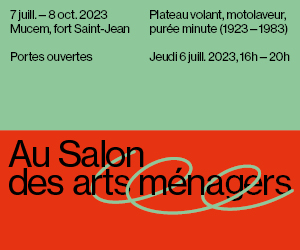
C’est à ce titre que se développent différents dispositifs à la frontière de l’école et du travail : mise en place du bac pro en 1985 (premier diplôme en alternance), rénovation de l’apprentissage (avec son extension à l’enseignement supérieur) en 1987 puis en 1992, la généralisation des stages (dont son introduction au collège), la professionnalisation des universités avec la création des licences et masters professionnels au tournant des années 2000.
La mise en place de ces dispositifs repose sur une affirmation, portée tant par les différents gouvernements que par le MEDEF, selon laquelle c’est en développant les temps de formation en entreprise que l’on favorise l’accès à l’emploi. Parce que l’entreprise serait formatrice et productrice de compétences, elle serait plus apte que l’école à préparer à l’emploi.
Ces choix politiques posent question.
D’abord l’affirmation selon laquelle les temps en entreprise favoriseraient l’accès à l’emploi peut être discutée. Si cette affirmation paraît évidente, c’est que la preuve en serait établie par les faits : différentes enquêtes menées tant par le Céreq que par le ministère de l’Éducation nationale concluent que les apprenti·e·s accèdent plus rapidement à l’emploi que les élèves de lycée professionnel. Cet écart bien réel est mis un peu rapidement sur le compte de la performance de la formation en entreprise occultant de ce fait les processus de sélection. En distinguant dès la sortie du collège, celles et ceux dit « employables » – les futur·e·s apprenti·e·s –, de celles et ceux dits « inemployables », les futur·e·s élèves de LP, les entreprises opèrent une véritable sélection. Comme je le souligne dans l’ouvrage que je viens de publier, trouver une place e
