École et santé mentale : inégalité de prise en charge du mal-être adolescent
Les données statistiques en santé mentale dressent un portrait alarmant de l’état psychique de la population française et internationale contemporaine : selon l’OMS, en 2019, une personne sur 8 dans le monde présentait un trouble mental, avec une prédominance des troubles anxieux et dépressifs.
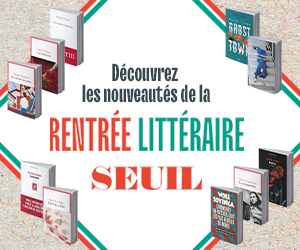
En France, une personne sur 10 a vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois (données de Santé Publique France, 2017). Les souffrances psychiques en population juvénile sont particulièrement préoccupantes : près d’un·e adolescent·e sur trois interrogé·e·s en 2014 par l’enquête de Unicef France dit avoir déjà pensé au suicide. La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale, en témoigne l’augmentation du nombre de passages aux urgences pour idées et gestes suicidaires entre 2019 et 2022, particulièrement marquée chez les adolescentes.
Les formes historiques spécifiques du mal-être adolescent
La sociologie a un rôle majeur à jouer dans l’appréhension des problématiques contemporaines de santé mentale, en complémentarité des autres sciences. La spécificité de son mode scientifique de traitement du sujet est d’éclairer les dimensions sociales du vécu subjectif, que la seule perspective biomédicale tendrait à minimiser ou occulter. Pour le sociologue, le domaine de la santé mentale est l’espace permettant de penser les points d’intersection entre des manifestations psychiques et un contexte social donné. Il fonctionne comme un révélateur des exigences sociales qui pèsent sur les individus, et des tensions produites par celles-ci via la production de symptômes polymorphes.
Dans la configuration actuelle de l’adolescence, les jeunes sont confrontés à trois univers socialisateurs centraux de contrôle social : le contexte familial, l’espace des amitiés juvéniles et l’institution scolaire. Ils constituent des supports puissants de subjectivation, médiateurs centraux dans la construction identitaire, sources de valorisatio
