Chat GPT ne va pas à l’école d’art
Les écoles d’art sont aujourd’hui menacées de fermeture, du fait de leurs déficits budgétaires auxquels s’ajoute une réduction des investissements de la part des instances publiques territoriales.
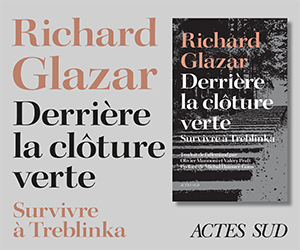
L’obtention, au bout de plusieurs mois de mobilisation, d’une aide budgétaire de 2 millions d’euros, n’entame pas l’inquiétude collective à leur sujet. Mais si la crise s’est déclenchée au début de cette année, la fragilisation des établissements supérieurs dédiés aux métiers des arts et de la culture relève d’un processus vieux de nombreuses années.
Incapables de s’adapter aux standards de rentabilité d’une industrie culturelle de plus en plus automatisée, ces institutions paraissent d’ores et déjà appartenir au passé. Pourquoi, dès lors, encourager des jeunes gens à s’inscrire dans des filières qui leur préparent un fort mauvais usage de leur potentiel créatif, alors qu’ils pourraient – et même devraient – appliquer plutôt leurs énergies au développement des activités liées à l’industrie de l’information, secteur où à l’inverse les investissements publics connaissent une augmentation exponentielle ? Pourquoi s’obstiner à défendre le monde d’hier, au lieu de se tourner dès maintenant vers l’avenir ? Pourquoi ne pas reconnaître que le besoin essentiel de « culture » est aujourd’hui plus qu’adéquatement satisfait par des produits qui ne réclament aucune des compétences fournies par les écoles d’art ? Pourquoi, alors, se battre pour préserver des institutions dont le maintien représente à vrai dire un gaspillage de fonds publics, lesquels pourraient être utilisés de façon bien plus bénéfique pour l’intérêt collectif, y compris les apprentis artistes eux-mêmes ? Ces étudiants ne savent-ils pas d’ailleurs qu’ils se condamnent à une vie de précarité et chômage, tout cela alors que leurs choix rétrogrades ne font que ralentir par défaut la marche en avant de l’innovation, pour tous ceux qui n’ont pas particulièrement besoin de leurs productions obscures et élitistes ?
