Transmission et deuil de l’analyste : anti-nécrologie de Gérard Pommier (1941-2023)
Simone de Beauvoir disait qu’elle avait eu une belle vie car elle avait réalisé presque tous ses désirs d’enfant. Pour ce qui me concerne, je n’ai accompli aucun de mes désirs d’enfant. Ai-je à mes propres yeux une vie laide ? Non.
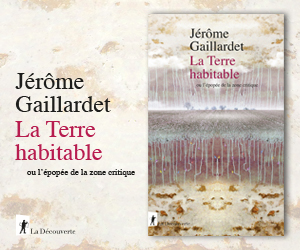
Si je n’ai pas l’impression d’avoir raté ma vie, je le dois, il me semble, à ma rencontre avec Gérard Pommier, qui a été mon analyste pendant de longues années. Au cours de cette analyse, j’ai découvert que ces désirs étaient inconsciemment construits pour rester insatisfaits – et j’ai appris à en inventer d’autres, dont celui de devenir moi-même analyste. Une vie psychanalytique est peut-être une vie dont la beauté se confond avec le deuil de ses désirs d’enfants : Gérard Pommier m’a rendue à la beauté de ma vie.
Gérard Pommier est mort le 1er août 2023. Pour moi, comme pour beaucoup d’autres personnes du monde psychanalytique, c’est une perte inestimable. Ses écrits et ses enseignements ont été très influents dans notre milieu. Il fut sans doute un des psychanalystes les plus lus de sa génération, peut-être le plus traduit. Il est l’un des premiers à avoir rompu avec le langage mimétique du milieu lacanien, pour renouer avec une langue certes pleine de mystères, mais de mystères qui ne sont pas différents de ceux des contes, des légendes, des mythes et des terreurs d’enfance – une langue qui n’avait pas peur de la poésie – une langue qui n’a pas besoin du non-sens pour faire mystère, mais qui est mystérieuse par son sens même. Il a contribué à faire naître des nombreux espaces institutionnels, au sein desquels beaucoup d’entre nous ont acquis la culture théorique dont on a besoin pour être analyste, créer ces liens de travail et d’amitié qui font une communauté, et appris en somme ce qu’on pouvait de ce métier.
Mais un ou une psychanalyste n’est pas seulement un.e écrivain.e, un chercheur ou une enseignante dont l’apport et la valeur de transmission pourraient être saisies par les livres qui restent ou les propos qu’on conserv
