Peut-on rêver d’être CPE ?
À l’heure où l’attractivité des métiers de l’enseignement semble problématique et que les médias et syndicats pointent le problème de la pénurie tant des candidat·e·s aux concours que des enseignant·e·s devant les élèves, il semble que la profession de Conseiller Principal d’Éducation (CPE) au sein des établissements scolaires ne rencontre pas les mêmes difficultés. En effet, le nombre d’aspirant·e·s à ce métier dépasse largement celui de postes de titulaires offerts.
Par ailleurs, le concours de CPE tient encore la réputation d’être relativement sélectif. En 2021, le rapport de jury précise qu’un peu plus de 10 % des candidat·e·s ayant passé le concours externe de CPE sont admis (270 admis pour 2603 présents). À titre de comparaison, le taux de réussite au CAPES externe était de 30.17 % la même année (avec des taux de réussite allant de 16.99 à 51.82 % pour les disciplines offrant plus de 200 postes).
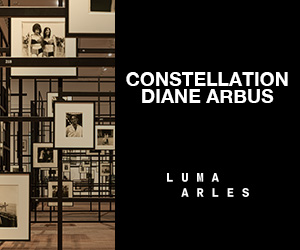
Le métier de CPE a été créé dans les établissements d’enseignement secondaire par le Décret n° 70-738 du 12 août 1970, qui le définit de la manière suivante : « Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ».
Il est depuis son origine marqué par la diversité et la polyvalence des tâches, qui ont connu des évolutions ces dernières décennies. Des responsabilités des CPE en matière d’évaluation et d’orientation des élèves ont ainsi été ajoutées en 1989. Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation de 2013 leur confie, en commun avec les enseignants et autres personnels d’éducation, la mission de transmettre aux élèves les valeurs républicaines et de les accompagner dans leur scolarité.
La dernière circulaire de mission qui date de 2015 leur assigne trois
