École : pour en finir avec une politique qui « donne un air de justice à l’inégalité »
« L’enseignement doit donc offrir à tous d’égales possibilités de développement, ouvrir à tous l’accès à la culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l’ensemble de la nation. »
Plan Langevin Wallon 1947.
Le 5 octobre dernier, à l’occasion de la journée mondiale des enseignants, le ministre de l’Éducation nationale a fait part de son ambition pour l’École – le « choc des savoirs » – et sa méthode pour y parvenir : une mission « Exigence des savoirs » composée d’inspecteurs, de recteurs, d’experts et de professionnels qui rendra ses conclusions dans deux mois, pour une première mise en œuvre dès septembre 2024.
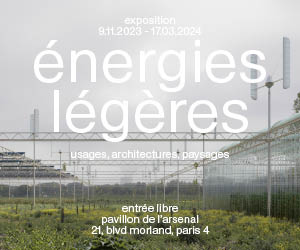
Pourquoi une nouvelle mission, alors que le constat est connu depuis les années 1970 et confirmé par le rapport de France Stratégie sur le poids des héritages et les parcours scolaires : l’origine sociale est la dimension qui pèse le plus sur les trajectoires scolaires, plus que le genre et l’ascendance migratoire.
Tous les spécialistes reconnaissent que « l’école à la française » vantée par le ministre comme « profondément égalitaire et farouchement universelle », est en fait profondément inégalitaire en raison du dualisme public privé – rappelons que dans le projet de loi de finances, le budget du privé augmente de 6,5 %, contre 4,5 % pour le secteur public –, de l’existence des quartiers défavorisés où sont concentrées les familles les moins riches et aussi du fait que l’absence de formation initiale et continue digne de ce nom ne permet pas que les réalités des élèves des milieux populaires soient assez prises en compte dans les pratiques pédagogiques.
Alors même qu’il lance une mission de huit semaines, le ministre prétend que les réponses sont connues et critiquant, sans données sérieuses, les cycles, l’hétérogénéité des classes et la diversité des pratiques et des manuels, entend proposer les solutions déjà impulsées par Jean-Michel Blanquer. Disons
