L’Afrique, laboratoire mondial d’une ignorance organisée ?
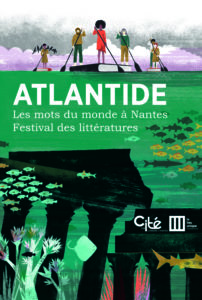
À Dakar (Sénégal) s’ouvre ce 2 février la conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation. Ce rassemblement bénéficie du parrainage conjoint des gouvernements du Sénégal et de France. Le président Emmanuel Macron y prendra part. Y participeront des bailleurs de fonds, le secteur privé, des fondations philanthropiques, des organisations internationales et la nébuleuse de la société dite civile. Vaste entreprise de communication, le but de la conférence est de récolter, à l’horizon 2020, deux milliards de dollars annuels qui seront consacrés à l’éducation dans les pays dits émergents. Cet énième para-téléthon n’est pas sans soulever d’importantes questions qu’il n’est plus possible d’éluder.
La course à la scolarisation
À peu près dans tous les pays africains, les années postindépendance auront été marquées par la course à la scolarisation. De fait, au cours de la période coloniale, peu de progrès avaient été réalisés dans ce domaine. L’économie coloniale était basée sur l’extraction des matières premières et des produits de rente. Elle avait, pensait-on, surtout besoin d’une main-d’œuvre primaire, abondante et à bas prix. Dans ces conditions, et compte-tenu de leurs capacités innées, lesquelles n’étaient guère infinies, exposer les indigènes à des formations spécialisées relevait du gaspillage. Il suffisait d’initier quelques intermédiaires à l’accomplissement mécanique des tâches élémentaires que requérait, par ailleurs, leur intégration subalterne au sein d’une économie vouée à l’extraversion.
C’est la raison pour laquelle pour beaucoup, la fin du régime colonial se confondit avec la conquête de la liberté d’apprendre. En effet, dix ans après la décolonisation, et malgré d’évidentes disparités, les taux de scolarisation grimpèrent considérablement. Les nouveaux États s’étaient emparés de la planification des besoins en matière d’éducation. Paradoxe, plus les taux de scolarisation grimpaient, plus – croissance démographique oblige – le no
