Samedi, j’ai insurrection : neuf leçons à tirer d’un mouvement intermittent
Nous participons tous et toutes aujourd’hui à une mutation de l’ordre du politique, dont les manifestations s’observent un peu partout autour de la planète et qui est suscitée par un même phénomène : l’instauration de contre-pouvoirs démocratiques à l’initiative de citoyen.ne.s qui entendent prendre en charge les affaires publiques qui les concernent. L’émergence inattendue du mouvement des « gilets jaunes » est la dernière expression en date de ce phénomène.
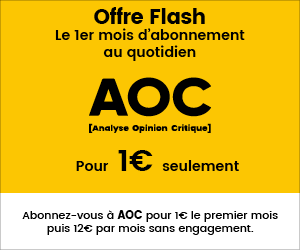
Elle jette une lumière crue sur le fait que la situation actuelle de la démocratie se caractérise par la coexistence de deux sources de légitimité : celle qui émane des institutions officielles du gouvernement représentatif et qui est essentiellement fondée sur l’élection et la délégation ; et celle qui naît des « pratiques politiques autonomes » des citoyen.ne.s – autonomes au sens de déliées de tout rapport avec les organisations traditionnelles de la représentation, et ne poursuivant aucun projet de conquête du pouvoir d’État [1].
Ce que certains nomment en ce moment la déconnexion entre le peuple et les élites renvoie à cette dualité des sources de la légitimité politique ; et à l’exacerbation de la tension qui naît de l’écart abyssal qui existe aujourd’hui entre représentants et représentés. Si cet écart a existé de tous temps, il s’est creusé de façon impressionnante avec les politiques de retrait programmé de l’État social qui ont traduit le tournant libéral des années 1970. Le choix de la globalisation de l’économie (fondée sur la liberté de circulation des biens et des capitaux) est au principe du développement des inégalités, de la suppression des droits sociaux et politiques acquis durant les années d’après-guerre, de la dégradation des conditions de l’emploi et du travail, de l’imposition de la concurrence comme principe de régulation sociale. Telle est la cause lointaine, et l’arrière-plan toujours actuel, de la colère exprimée par les « gilets jaunes ». Et les attaques systématiquement menées de
