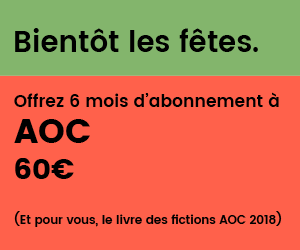La France contrainte des Gilets Jaunes
Les trois semaines qui ont séparé le moment fondateur du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre, des premières annonces gouvernementales relatives à l’abandon de la hausse des prix du carburants puis au soutien du pouvoir d’achat, le 10 décembre 2018, ont permis aux analystes et aux chercheurs de faire la découverte d’un mouvement social totalement inédit dans son origine, dans ses vecteurs de mobilisation comme dans ses effets territoriaux.
Faute de précédent, et avec aussi peu de recul, l’analyse se doit de rester humble sur le sujet. Toute tentative de catégorisation tombe bien souvent dans la caricature et le réductionnisme. S’il est difficile de saisir toute la diversité des facteurs explicatifs à ce mouvement, il est cependant possible de dire au moins ce qu’il n’est pas. On souhaite en particulier revenir sur l’affirmation galvaudée d’un mouvement qui serait issu de la « France périphérique », et qui viendrait s’opposer à une autre France, celle de l’élite et des métropoles, en une sorte de répétition du jeu éternel des luttes entre dominants et dominés – mais qui prendrait, désormais, une forme spatiale. Cette explication est commode, car elle est binaire et simpliste ; elle permet de radicaliser les positions et galvanise les foules. Elle est pourtant fausse, tout comme l’est l’idée même de la France périphérique.
Plus qu’une périphérie, c’est la marge périurbaine qui domine
Il existe bien entendu un facteur géographique qui semble évident pour justifier l’idée d’une opposition entre métropoles privilégiées et France périphérique : celui de la distance, et du coût croissant de la facture d’essence à mesure que l’on s’éloigne des centres d’agglomération. La distance à la ville est bel et bien un paramètre incompressible pour accéder à un emploi, aux qualifications et/ou aux services, dans la mesure où ces facteurs tendent à se concentrer toujours plus dans les principales agglomérations du territoire national. Ce coût de la distance ouvre ain