Fractale du discrédit
« On montre du doigt, on s’indigne, on fait un éclat, pour écarter,
pour mettre à distance de soi et des autres – de soi sous le regard des autres –
cela même par quoi on est en danger d’être attiré, séduit ou piégé. »
Marcel Détienne
L’Invention de la mythologie
Souvent imité, jamais égalé, l’essai de Roland Barthes Mythologies s’est imposé depuis sa parution en 1957 comme un modèle pour quiconque s’efforce d’analyser les mythes qui gouvernent la vie quotidienne dans nos sociétés dites de consommation. Les Mythologies de Barthes n’ont pas cessé d’intéresser les lecteurs alors que la plupart des objets, des situations ou des personnages qui en constituent la matière ont disparu et sont tombés dans l’oubli.
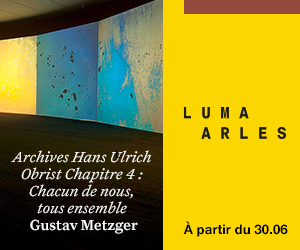
Qui est fasciné aujourd’hui par le catch, le plastique et le formica, l’abbé Pierre, l’acteur d’Harcourt, Pierre Poujade, le strip-tease, la nouvelle DS Citroën ? Qui se souvient de la marque Astra, de Minou Drouet, de la croisière du Batory, de l’affaire Dominici, de l’euphorie d’Omo, du mariage de la fille du duc de Castries et du baron de Vitrolles, de Fiévet Bichon, « Bichon chez les nègres » ?
L’aura qui se dégage des mythologies barthèsiennes n’appartient donc pas aux objets eux-mêmes, à leur substance, mais au geste du mythologue qui les recueille, les décrit, les décrypte… Roland Barthes dévoile sous la surface des choses muettes des significations cachées. Son travail consiste à élire comme mythes des choses ordinaires, banales, nettoyés de la gangue de leur fonctionnalité. Il en fait des mythes pour mieux les démystifier. Son écriture agit comme un pinceau qui époussette la pellicule idéologique qui les enveloppe avant de les exposer aux regards. L’aura de nostalgie qui les entoure est semblable à la patine du temps sur les vestiges d’un monde perdu. Les Mythologies de Barthes nous parlent d’un univers envouté, peuplé de fausses croyances et de fétiches qui ne demandent qu’à être interprétées.
C’était le temps heureux de la conscience critiqu
