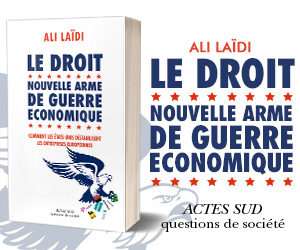École de la confiance, vraiment ? À propos de la formation des enseignants
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a récemment vanté sa loi sur « l’école de la confiance » dans une interview donnée au journal Le Monde. Cette loi, selon ses propos, devrait constituer la « matrice d’une société de la confiance » et serait fondée notamment sur la « bienveillance » et sur « l’évaluation ». À l’examen, cette vision paraît pourtant très éloignée du contenu réel des textes votés, qui sont porteurs de régressions et de dangers pour l’école publique.
La formation des enseignants est un des éléments importants abordés dans cette loi ; il n’a fallu que quelques minutes pour que soient adoptés en première lecture des articles dont les conséquences risquent d’être catastrophiques pour les futurs professeurs et pour les élèves, en particulier ceux des classes populaires qui ont besoin, plus que tous les autres, d’enseignants bien formés, capables d’engager les élèves dans des apprentissages bien construits.
En date du jeudi 21 février 2019, le ministère a également adressé une « note aux rédactions » des grands journaux français intitulée : « Devenir enseignant : une meilleure formation initiale et des parcours plus attractifs pour entrer dans le métier », étonnantes pages de communication visant sans doute à tenter de faire en sorte que les journalistes n’aient plus besoin d’enquêter… Formateurs de l’académie de Créteil, nous entendons répondre ici à cette communication du ministère sur la réforme de la formation des enseignants, comme à l’entretien du ministre paru dans Le Monde.
Une loi de régression et de déréliction
La loi institue tout d’abord un dispositif dit de « pré-professionalisation » : elle prévoit dans l’article 14 que « des assistants d’éducation pourront se voir confier des charges d’éducation, de pédagogie et d’enseignement ». Présentée par le ministre comme une « formidable mesure sociale » en faveur des étudiants, alors qu’elle est ouverte sans condition de ressources, cette disposition est en réalité