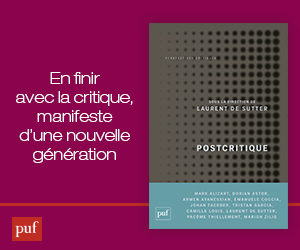De la réquisition de l’Université par l’appareil productif
Le 21 février dernier, le Comité d’Administration de PSL, communauté regroupant plusieurs établissements parisiens (comme l’ENS, les Mines, l’ESPCI, ou encore Paris-Dauphine), annonçait la création votée d’un cursus de licence en partenariat avec la banque privée BNP Paribas, mécène du projet à hauteur de 8 millions d’euros. La licence nommée « Impact positif » se présente comme une formation pluridisciplinaire axée sur l’étude des « sciences du développement durable » dont le programme sera déterminé à partir des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
L’évènement paraît banal à première vue et pourrait même paraitre réjouissant : l’université et un acteur majeur du système bancaire mondial semblent ici montrer leur volonté de soutenir par « la formation des générations futures aux objectifs du développement durable » une authentique vision alternative du monde, portée tant sur l’écologie que sur des revendications de justice sociale.
Ne soyons pas naïfs : par-delà la « com’ » institutionnelle et les effets d’annonce, l’alliance entre PSL et la BNP est révélatrice de plusieurs phénomènes qui, en vérité, ne prêtent guère à se réjouir.
La création de cette licence révèle, de façon inédite, une tendance fondamentale de l’histoire récente de nos institutions d’enseignement et de recherche. C’est en effet la première fois qu’un acteur privé s’introduit de manière aussi franche dans la vie de l’université française, qui jusqu’à présent revendiquait son indépendance financière à l’égard des acteurs privés. Certes, on pourrait croire qu’il ne s’agit que d’un mécénat qui laisserait en théorie le champ libre à l’université pour déterminer les formes et contenus des enseignements. Mais c’est manquer de voir combien cette mesure affecte les principes mêmes qui constituent notre idée de l’université, comme son ambition.
Les raisons de la colère
Depuis l’annonce de ce partenariat, une contestation très vive a émergé au sein des organisations étudia