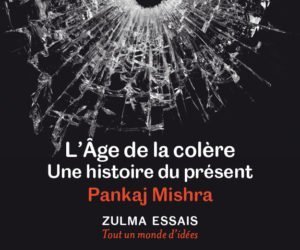Le savant et le politique se parlent-ils encore ?
Si l’on avait encore besoin d’une preuve, le fameux débat organisé sur proposition du président de la République avec des « intellectuels » devrait avoir achevé de nous convaincre : les universitaires ne semblent actuellement pas les vecteurs privilégiés de changements politiques majeurs – ni même mineurs d’ailleurs. Cette situation est-elle conjoncturelle ? Cela ne fait-il pas plutôt bien longtemps qu’il en va ainsi ?
Certes, tout était réuni ce 18 mars, pendant ces près de 9h de rencontre entre Emmanuel Macron et les intellectuels pour qu’il ne se passe rien d’essentiel : il s’agissait en effet d’abord pour le pouvoir de montrer que des « compartiments » variés de la société avaient été « consultés » mais aussi sans doute de rappeler que le président de la République était tout aussi capable de maîtriser les arcanes d’une discussion avec les producteurs d’idées et de concepts qu’avec les femmes et hommes d’action, avec des savants qu’avec des politiques. J’ai raconté ailleurs l’impression assez désagréable qu’avait provoqué sur moi cette mise en scène apparemment disposée pour l’écoute mais s’étant très vite révélée n’être – comme dans le cas des débats avec les maires – qu’un dispositif de mise en valeur des convictions de notre hôte.
Par ailleurs rien, ni le temps laissé à chacun pour exposer sinon ses idées, au moins sa question, ni le grand nombre que nous étions, ni l’absence de ceux qui étaient le plus en désaccord avec ce qu’ils considéraient comme une mascarade, n’était propice à l’ouverture d’un temps et d’un espace susceptibles de déboucher sur ce que la discussion scientifique peut produire de meilleur : un apprentissage mutuel, un intérêt allant jusqu’à l’adoption de l’idée de l’autre, une possible transformation intérieure, une éthique de la responsabilité soudainement infléchie par l’éthique de la conviction.
Très vite la messe fut dite : la plupart des propos non immédiatement compatibles avec les convictions du président furent jugés sin