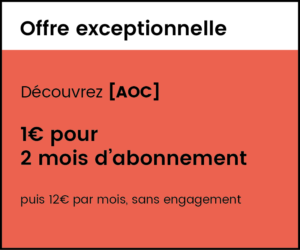Le piège épistocratique – libéralisme vs populisme 2
Le consensus néolibéral autour duquel, par-delà l’ancien clivage gauche-droite, gravitent depuis quelques années les gouvernants, nourrit une tendance qui est corrélative de la dimension post-politique du nouveau clivage qui oppose aujourd’hui le populisme aux tenants d’une société ouverte et libérale. Cette tendance, à laquelle je faisais allusion pour conclure le premier volet de cette étude, érige l’expertise au rang d’acteur fondamental du nouveau clivage. La philosophie politique anglo-saxonne lui a donné un nom : l’épistocratie.
Elle est fondamentale dans la mesure où les gouvernants, pour mieux disqualifier l’adversaire et justifier l’adaptation du droit aux contraintes du marché, se parent de la neutralité du savoir en se disant pragmatiques. Pour bien saisir cette instrumentalisation du savoir scientifique par le discours néolibéral, un détour s’impose pour définir la notion d’épistocratie. L’étymologie de cette notion, largement diffusée en Amérique du nord mais très peu usitée en Europe continentale, renvoie à l’idée d’un pouvoir (cratos) exercé par les détenteurs du savoir scientifique (épistémè). Le terme pourrait ainsi servir à désigner un mode de gouvernement susceptible de rentrer dans la typologie des régimes politiques à la même enseigne que la démocratie, l’aristocratie ou la monarchie. C’est ainsi que certaines dérives contemporaines de la démocratie ont donné raison aux tenants de l’épistocratie.
La montée du populisme en Europe, le vote populaire en faveur du Brexit, l’accession de Donald Trump à la Maison Blanche ou l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil ont été attribués, pour partie, aux effets néfastes des fake news diffusées sur le web et ont conduit certains auteurs américains à l’instar de Bryan Caplan ou de Jason Brennan, à s’interroger, à l’heure de la post-vérité, sur les failles du vote démocratique. Jason Brennan mettait en doute la fonction épistémique de la démocratie et se demandait si le peuple était suffisamment armé