L’architecture et la tentation du vernaculaire
Il y a des mots qui mettent tout le monde d’accord. Des mots plastiques, déformables à l’envi, capables de revêtir, au même endroit, au même moment, autant de sens qu’il n’y a d’individus qui les partagent. Des mots qui neutralisent le débat par leur capacité à en absorber toutes les nuances. Prononcez aujourd’hui le mot « vernaculaire » au milieu d’une assemblée d’architectes ou d’artistes, et même de designers, et toutes et tous opineront du chef : en ces temps troublés, où les enjeux de frugalité écologique du monde rejoignent ceux de sa modération économique, le « vernaculaire » est un modèle à suivre.
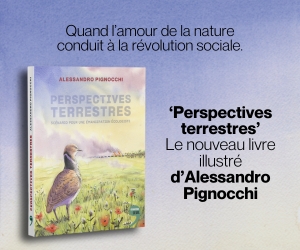
Chez les architectes, où le mot est actuellement particulièrement diffus, l’idéal est pourtant loin d’être univoque. Autour de la table des discussions, une première personne pensera sûrement aux « architectures sans architectes », regroupées par Bernard Rudofsky au MoMA en 1964, fantasmant l’ingéniosité économe de cette construction « anonyme, spontanée, indigène, rurale[1] ». Quant à son voisin, il rêvera aux ouvrages de terre érigés aux quatre coins du monde, répertoriés par Jean Dethier depuis les années 1980. Un autre lira dans la construction « avec le peuple » vantée par l’architecte égyptien Hassan Fathy, une expérience d’empouvoirement des habitantes et habitants d’un lieu, bien qu’il faille nuancer cette lecture. Tandis que la jeune diplômée, tout juste échappée de l’école d’architecture, aspirera à la retraite de « l’architecte de campagne » cantalien, Simon Teyssou, en quête d’un récit « alter urbain ». Enfin, le concepteur désespéré de l’impact de ses projets bétonnés, se réjouira de la perspective de réduire son bilan carbone que lui offre le chantre de la pierre massive, le Grand Prix national d’architecture 2024, Gilles Perraudin.
Le vernaculaire est équivoque. C’est cependant souvent sous forme d’objets idéalisés tels que des hameaux ruraux, des hangars à fourrage, des abris pour élevage et des remises agricoles construits par celles et ceux qui les vivent, qu’il peuple l’imaginaire des conceptrices et concepteurs aspirant aujourd’hui à « faire vernaculaire » en agençant des matériaux dits « naturels » (terre, pierre, bois, paille) et une collection de fragments signifiants caractéristiques de ces modèles. Ainsi, couvertures à double-pente, enfilades de chevrons et murs de pisé sont érigés pour abriter des centres médicaux, des salles des fêtes et des logements dans les petits bourgs, les villes moyennes et les périphéries métropolitaines. Ils sont présentés en antonymes de l’abstraction insipide des murs rideau, toitures plates et autres façades tramées des bureaux de la ville générique, abandonnée aux investisseurs financiers.
Absent du dictionnaire de l’Académie française jusqu’à la publication en 2024 de son ultime tome, le mot « vernaculaire », affilié au domaine de la linguistique pour désigner « par opposition à la langue nationale, la langue ou le dialecte utilisés par une communauté dans la vie quotidienne », navigue depuis longtemps en architecture. Il embarque aujourd’hui dans l’esprit de celles et ceux qui en manipulent les images et les imaginaires, des valeurs de modération matérielle, d’ancrage, de proximité entre l’humain et son environnement, d’authenticité même – c’est-à-dire de spécificités distinctives locales, face à l’identité dissoute des impersonnelles métropoles. Bref, quand il est convoqué en architecture, vernaculaire est un mot savant pour instaurer en modèle ce qui ne l’est pas, sous-entendu ce qui a résisté au rouleau compresseur de la modernité. Et il renaît aujourd’hui en vertu écologique, et passe d’outil de description à concept opératoire.
Car l’architecture d’inspiration vernaculaire est parfois présentée par celles et ceux qui la vantent comme une alternative « de bon sens » aux constructions standardisées de nos villes congestionnées, « sans histoire » et dont « l’attrait principal est (leur) anomie[2] ». Nos villes globalisées, qui ont rompu tout lien avec leur contexte géographique et culturel, et dont les architectes devraient impérativement se détourner pour revendiquer une position régionaliste, précisément située. On nous dit que, parce qu’elle puise ses matériaux autour d’elle, l’architecture d’inspiration vernaculaire ne cède pas aux sirènes de l’industrialisation de la construction. On nous dit qu’elle est ancrée justement parce qu’elle mobilise des savoir-faire spécifiques au territoire où elle s’installe. On nous dit aussi qu’elle est économe par essence, car elle ne s’orne de rien qui ne répondrait pas à des exigences fonctionnelles. Qu’elle est raisonnée et raisonnable, parfaitement à l’échelle de son climat et des nécessités de ses usages. Enfin, on nous dit surtout qu’elle est vertueuse, affranchie des marottes esthétiques de ses concepteurs et conceptrices car elle mobilise des formes et des modes constructifs éprouvés par le temps, identifiables et identifiants pour ses habitantes et habitants.
Difficile de ne pas se réjouir que des positions moins pétrolifères se dessinent dans le monde de la construction, alors que le secteur représentait encore, en 2022, 37 % des émissions mondiales de CO2. Cependant, le retour de l’inspiration vernaculaire en architecture doit être étudié pour ce qu’il est, c’est-à-dire un acte de langage des architectes, un positionnement aux implications politiques parfois risquées. Ceci étant dit, il ne faut pas lire dans cette contribution un « retour de bâton » : il ne s’agit en aucun cas, en miroir de ce travail critique, de légitimer des pratiques de greenwashing qui bâtissent à grande échelle des perspectives anti-écologiques.
Authentiques simulacres et architectes de génie
Nostalgiques des images de constructions archaïques habitant des paysages pré-métropolitains, ainsi que des usages traditionnels de la matière censés les façonner, certaines et certains architectes entretiennent une fascination esthétisante pour des objets qu’elles et ils figent dans le passé et déconstruisent en une série d’images séduisantes, faciles à assembler dans de nouveaux projets. Promouvoir l’architecture d’inspiration vernaculaire devenant avec elles et eux une posture identitaire autant que défensive ; une sorte de contre-révolution qui réveille une vieille opposition ville-campagne, en vis-à-vis du projet néolibéral de la métropole générique. En somme, un « projet populiste » et même une forme de « populisme esthétique », suivant les descriptions de l’historien Federico Ferrari[3], c’est-à-dire « un discours sur et par l’architecture » formulé et diffusé par des élites, à propos de savoirs extérieurs à eux-mêmes, avec l’objectif de soutenir un projet politique.
Déconstruit en un catalogue de fragments signifiants (profil de toiture, rythme et hiérarchie de percements, dessin de charpente, agencement de matériaux, etc.), le vernaculaire devient un principe combinatoire capable de se déployer partout, plutôt qu’un outil de description ; alors même qu’il est instauré en modèle parce qu’il résulte de conditions climatiques, matérielles, culturelles et économiques spécifiques, donc logiquement impossibles à reproduire. Ce faisant, sous prétexte de pensée écologique, c’est à la fabrication d’authentiques simulacres de façade qu’on assiste. C’est-à-dire à une manipulation sélective de signes, qui prolonge les habitudes d’une culture dominante à instaurer des cultures dominées[4]. Cela interroge, quand on sait qu’un bâtiment qualifié de vernaculaire aujourd’hui peut être le fruit d’un projet colonisateur, comme l’expliquent sans naïveté Justine Lajus-Pueyo, Alexia Menec et Margot Rieublanc dans What about vernacular ?[5], récit illustré de leur découverte du patrimoine traditionnel de l’Est des États-Unis, construit par des pionniers européens sur les ruines de la culture d’habiter amérindienne.
Que devient également l’autonomie et la liberté transgressive du vernaculaire quand il est ordonné, planifié, pour emprunter une voie dogmatique, celle de sa diffusion par des architectes ? Faire du vernaculaire un art d’expert, c’est aller à l’inverse des manières de le conceptualiser du philosophe Ivan Illich, qui le place là où l’humain assure sa propre subsistance quotidienne, en dehors des institutions de contrôle[6]. C’est aller à l’inverse aussi des réflexions de la philosophe bell hooks à propos du « black vernacular », qui établit qu’à l’image de toute pratique architecturale, une culture d’habiter dénuée de privilèges matériels, n’est pas dénuée d’engagements constructifs significatifs, ni de relations à l’esthétique[7]. En réalité, en architecture, le vernaculaire n’échappe pas aux normativités des architectes-auteurs qui se pensent seuls capables de l’instaurer en « avant-garde éclairée »[8].
À bien y regarder, la combinaison de fragments empruntés aux constructions alentour ne camoufle d’ailleurs que peu la mise en ordre rigide d’espaces conditionnant, dont la sévère composition suggère plutôt une indifférence aux modes d’habiter du contexte et aux types qui les qualifient. Continuer à revendiquer, chez les tenants de l’exemplarité vernaculaire, la fabrication « d’œuvres » par un architecte-artiste et sa position de « maître », participe de la même logique excluante[9]. De même que convoquer l’immanence de l’architecture plutôt que sa contingence n’est-il pas antinomique quand il s’agit de concevoir et construire « avec les moyens du bord » ? Au fond, lorsqu’on convoque l’inspiration vernaculaire, est-il question de « génie du lieu » ou de génie de l’architecte à même de le convoquer ? Et ce faisant, est-il question de mettre au travail le positionnement surplombant de ce dernier ?
Du côté des institutions, que veut dire montrer en exemple aujourd’hui ces pratiques face aux enjeux écologiques ? En distinguant ces « manières de faire vernaculaire », elles entretiennent l’individualisme des architectes-auteurs, plutôt que d’interroger leur capacité à entrer en relation avec ce, et avec celles et ceux qui composent leur environnement. Alors que d’autres architectes – médiateurs ? enquêteurs ? mésologues ? – imaginent des systèmes de représentation et d’actions plus collectifs, plus partagés, pour fabriquer des abris qui se fondent avec évidence, et même discrétion, dans leur contexte métropolitain et a-métropolitain, on semble assister à une panique identitaire des architectes-auteurs[10]. Soutenus par des institutions qui peinent à regarder ailleurs, elles et ils opposent leur argumentaire colonisateur aux membres de leur groupe professionnel qui interrogent leurs manières excluantes – et parfois même violentes – de faire.
Un régionalisme pas critique
C’est donc moins aux modes de vie en lien avec un environnement qu’aux images, que l’architecture contemporaine d’inspiration vernaculaire s’intéresse. En ce sens, elle illustre peut-être ce qui peut être vu comme un nouveau régime de matérialité[11], où l’usage des matériaux bio-sourcés et géo-sourcés fait l’objet d’une mise en scène soignée, qui valorise les filons d’extraction, les filières de production et la trace des gestes qui manipulent cette « ressource naturelle précieuse » – en opposition au « produit artificiel dangereux » que constitue désormais le béton, suivant une nomenclature moderne à interroger. Les gestes des « artisans locaux » deviennent expression architecturale pour valoriser « l’authenticité » de l’ouvrage. D’après l’historien Jean-Louis Cohen[12], c’était « l’ouvriérisme » qui guidait plutôt la conception des maisons Jaoul de Le Corbusier (Neuilly, 1953) ou celle des « Briques Rouges » de Paul Chemetov (Vigneux, 1964-1967), rendant visible le travail des maçons pour inscrire l’architecture dans son contexte urbain et social. S’il fallait hier humaniser la modernisation de la construction, il faut renouer avec « ce que sait la main[13] » à l’heure de son écologisation.
À chaque époque son vernaculaire. Et en appeler à un retour à la pré-standardisation, c’est oublier que dans l’histoire de l’architecture, le vernaculaire ne fut pas toujours exclu de la société de consommation. Il a pu aussi être construit à partir de celle-ci, comme quand les architectes américains Robert Venturi, Denise Scott-Brown et Steve Azenour « héroïsaient l’ordinaire » commercial et contrefait du strip de Las Vegas, en érigeant en modèle d’une architecture adaptée à son contexte, le réel quel qu’il soit[14].
En convoquant des modèles figés dans le passé, l’argumentaire vernaculaire tel qu’il est souvent diffusé actuellement en architecture entretient une vision décliniste de la société. De même que si elle est mise en œuvre par un petit nombre d’individus, pour une petite communauté définie en dehors des centres de densité, cette architecture contemporaine d’inspiration vernaculaire esquive la question de l’échelle de son impact. Le régionalisme actuel des architectes oublie parfois d’être critique. Opposant les perceptions du monde – local et situé d’un côté, global et déterritorialisé de l’autre –, leur discours n’a pas la profondeur du rapport dialectique que proposait le « régionalisme critique » conceptualisé par l’historien et théoricien de l’architecture Kenneth Frampton en 1983[15], sous l’égide de Paul Ricœur qui, dans le contexte de la décolonisation, posait le problème de la rencontre entre civilisation universelle et cultures nationales.
Si l’architecture postmoderne naît dans l’opulence des années 1980, dans l’étiolement des grands-récits, d’après le philosophe Jean-François Lyotard[16], et par l’affirmation d’une nouvelle cohérence multipolaire d’un monde soumis à la logique du marché, d’après le théoricien de la littérature Fredric Jameson[17], le retour de l’inspiration vernaculaire en architecture peut être lue comme une traduction des discours politiques qui traversent aujourd’hui un monde qui s’organise autour d’une nostalgie des identités perdues, construites en négatif, c’est-à-dire à partir de ce qu’elles rejettent. Dire cela, c’est renverser la perspective constructiviste qu’aiment à entretenir les architectes : c’est la société qui leur dicte des manières de faire, plutôt que ces derniers qui la façonnent.
Il ne s’agit pas ici de se faire censeuse, encore moins de servir de caution aux « anti-vernaculaires » et aux dérives architecturales et constructives écocidaires. Il s’agit plutôt d’appeler à la nuance. Car, comme les architectures totales de la ville néolibérale imagent le régime qui les façonne sans l’interroger, l’architecture contemporaine inspirée du vernaculaire court chaque jour le risque d’être instrumentalisée par des groupes politiques en quête d’une illustration efficace de leurs arguments réactionnaires.
