Le pluralisme de la recherche et l’accès à l’enseignement supérieur
Le débat actuel sur le processus de qualification par le CNU (Conseil National des Universités) nous donne l’occasion de réfléchir à une question que pose cette procédure centralisée au regard du pluralisme, c’est-à-dire la diversité des champs de recherche et des approches de chaque discipline. Comme l’a montré Bourdieu dans Homo academicus, le milieu universitaire est bien le lieu de lutte de pouvoir, entre les disciplines et à l’intérieur de chaque discipline. Or, le système français d’accès à l’enseignement supérieur, étant centralisé, est particulièrement nocif pour la diversité et donc la vitalité de la recherche ainsi que pour l’éclosion de nouvelles approches.
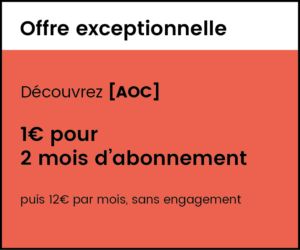
La porte de l’enseignement supérieur en France – autrement dit l’accès aux statuts de maître de conférences et de professeur – est gardée par deux institutions centralisées : le CNU (divisé en sections représentant autant de disciplines) et, de façon minoritaire, l’agrégation (pour le droit, la science politique et les sciences de gestion, l’agrégation d’économie étant suspendue) qui permet de devenir, le cas échéant directement, professeur. Ces deux procédures gardent l’entrée des deux statuts stables qui forment l’université française : le statut de maître de conférences et de professeur, l’université française ayant fait le choix, regrettable à nos yeux, d’un système de double tenure, inconnu ailleurs, mais ceci n’est pas le sujet. Nous le disions plus haut, le choix d’un mode centralisé de sélection des universitaires peut avoir pour effet de censurer et de faire disparaître les modes de pensées, les recherches ou même les disciplines minoritaires.
Pour étayer cette affirmation, prenons quelques exemples dans les sections de science politique, d’économie et enfin en droit.
La section de science politique du Conseil national des universités a publié une motion adoptée à l’unanimité le 7 février 2019, qui reflète bien les conflits dans la discipline et la façon dont le CNU peut se faire l’auxiliaire
