Le roman d’apprentissage du capital humain ou l’invisibilisation du social (1/2)
«La nature d’une période peut se lire en général sur sa façade architecturale », écrivait le romancier autrichien Hermann Broch dans les années 1930. Cette réflexion, valable de tout temps, s’applique à notre époque à condition de préciser que cette façade n’est pas faite de verre et de béton, mais de cristaux liquides et de pixels.
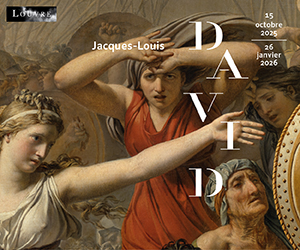
Elle s’offre aux regards non pas sur les murs des grandes villes mais sur les nombreux écrans qui ont envahi notre vie quotidienne. Nous marchons, nous agissons, nous désirons, nous souffrons – à l’intérieur d’un grand livre ouvert, dont les pages sont des écrans et les marges des interfaces. Comme les agents de la circulation d’autrefois, plantés au milieu des carrefours, les Gafam, ces nouveaux agents de la narration numérique, régulent aujourd’hui des flux d’histoires et de données. Ils ne contrôlent plus des corps en mouvement mais des subjectivités en transit.
Que disent de notre époque ces écrans qui ont envahi nos vies, peuplant notre imaginaire d’un foisonnement d’histoires, d’images et de voix qui circulent via YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn… (dont la liste n’est certainement pas close) ? Quel monde se donne à lire dans ce clignotement incessant de vidéos éphémères qui, mises bout à bout, forment la trame de notre temps ? Difficile à dire. Car cette trame ne se présente pas comme un continuum d’expériences, mais comme une mosaïque vibrante, instable, composée d’une multitude de micro-récits, de fragments d’images et de données qui se répètent en boucle sur nos écrans.
Quatre révolutions enchevêtrées
L’essor contemporain du storytelling au milieu des années 1990 est la résultante de quatre révolutions enchevêtrées qui marquent la période récente. Il est vain de chercher à les hiérarchiser tant elles s’entremêlent, s’influencent et convergent vers un même basculement civilisationnel.
1. La révolution capitaliste d’abord, incarnée par la mondialisation néolibérale et la financiarisation des marchés. Elle
