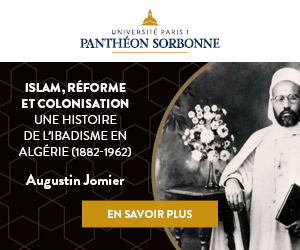Droit, gauche et contestation – histoires croisées
La décision « Liberté d’association » de 1971 est bien connue des juristes car elle est considérée comme le moment fondateur par lequel le Conseil constitutionnel se pose en gardien des libertés fondamentales[1]. On porte moins souvent attention au fait que le recours fut déposé au nom de deux personnalités peu connues pour leur connaissance du droit, Michel Leiris et Simone de Beauvoir. En effet, les deux intellectuels s’étaient vus empêchés par l’administration de créer l’association Les amis de la Cause du peuple, en soutien au journal maoïste officiellement dirigé par Jean-Paul Sartre.
Après un premier recours victorieux devant le tribunal administratif de Paris, le ministre de l’intérieur Raymond Marcellin « élabora alors une nouvelle loi dont l’article permettait de soumettre a priori au contrôle de l’autorité judiciaire la déclaration d’une association lorsqu’elle “apparaissait” fondée sur une cause ou en vue d’un projet illicite »[2]. Sollicité par Alain Poher, alors président du Sénat, le Conseil constitutionnel se saisit de cette opportunité pour étendre sa propre juridiction, en intégrant le préambule de la Constitution dans son visa et donc les principes fondateurs de la société démocratique, comme l’indique Dominique Schnapper.
C’est donc, d’une certaine manière, et bien que cela soit rarement souligné, grâce aux maoïstes et aux intellectuels qui les soutenaient au début des années 1970 que l’on doit le retournement jurisprudentiel par lequel le Conseil constitutionnel affirma son rôle prééminent dans l’ordonnancement judiciaire français, jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2008 qui acheva sa reconnaissance en tant que Cour constitutionnelle à part entière.
La rencontre improbable du droit constitutionnel, de Simone de Beauvoir et de Michel Leiris, au secours des jeunes maoïstes, constituant la bête noire d’un ministre de l’intérieur bien décidé à se débarrasser de toute velléité de provocation gauchiste ne constitue pourtant ni une anoma